

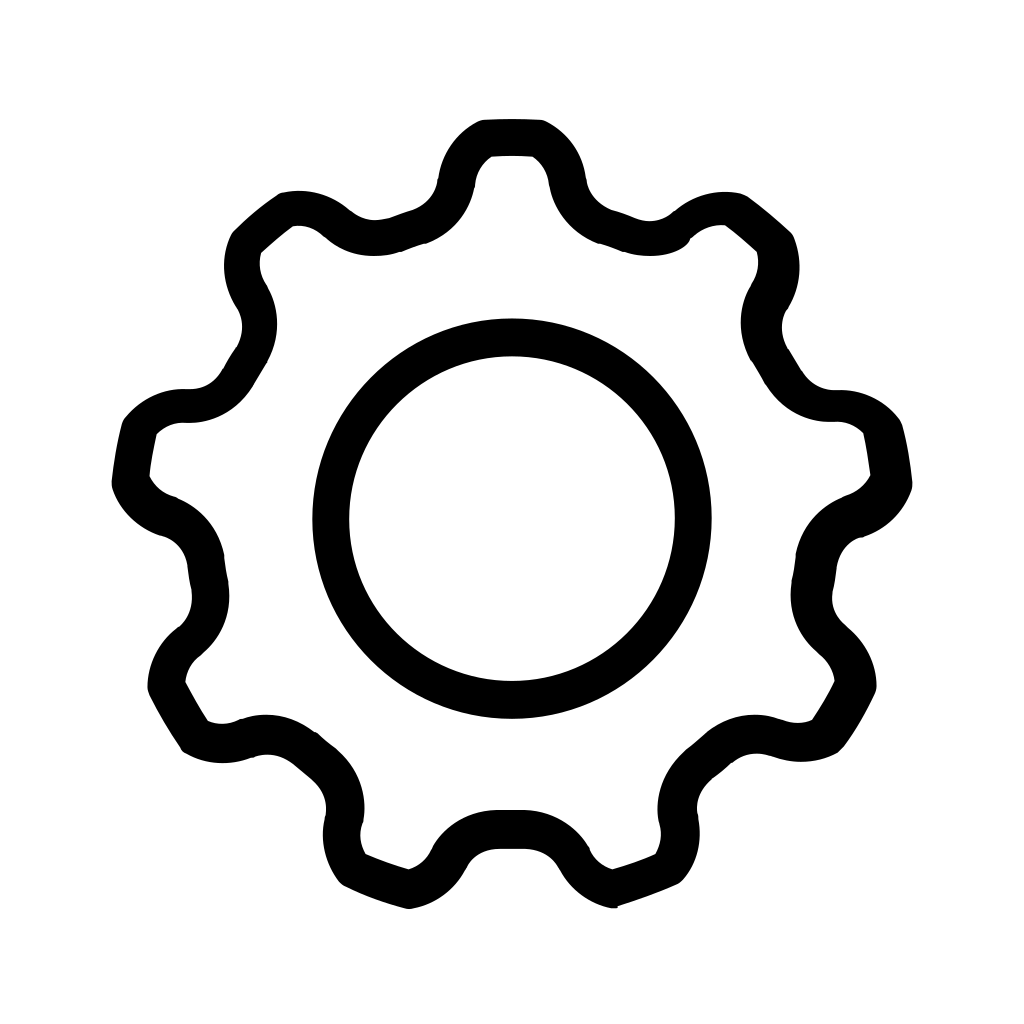
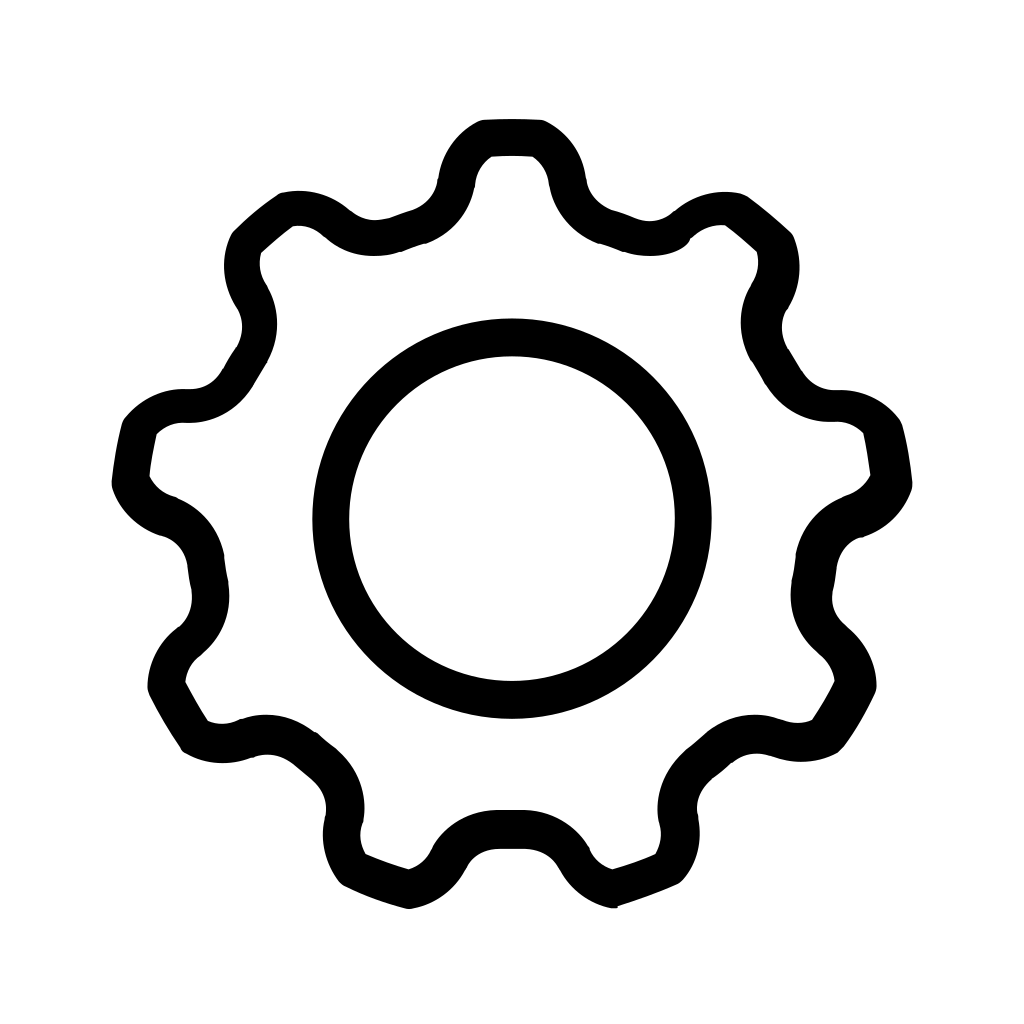
Pour une lecture optimale, visualisez cette page sur ordinateur.

 L
e 17 juillet 1956, ma mère m'infligea la vie.
Pourquoi dans cette ville ? j'aurais dû voir le jour à Nîmes si mon père en tant
qu’officier de marine de réserve avait dû quitter son travail à Marcoule.
pour rallier vraisemblablement le
Gustave Zédé.
L
e 17 juillet 1956, ma mère m'infligea la vie.
Pourquoi dans cette ville ? j'aurais dû voir le jour à Nîmes si mon père en tant
qu’officier de marine de réserve avait dû quitter son travail à Marcoule.
pour rallier vraisemblablement le
Gustave Zédé.


 A
près quelques mois à Brest, mon père trouve un poste sur le site
nucléaire de Marcoule. La famille s'installe à Saint Nazaire situé à une
dizaine de kilomètres. De cette période, il me reste peu de souvenirs.
A
près quelques mois à Brest, mon père trouve un poste sur le site
nucléaire de Marcoule. La famille s'installe à Saint Nazaire situé à une
dizaine de kilomètres. De cette période, il me reste peu de souvenirs.

 C'
est là que j’attrape la toxicose. Après trois mois
d’hospitalisation en soins intensifs à l'hôpital de Nimes, mon cas
est jugé désespéré. Il n’y a plus rien à faire. Aussi, les praticiens
décident d’arrêter tout traitement.
L’acharnement thérapeutique n’était pas encore de mise. Et c’était
très bien ainsi. Ça ne durera pas. Toujours est-il qu’à la suite
de cette décision, les médecins proposent à mon père de revenir le
lendemain pour récupérer le certificat de décès. En principe je ne
devrais pas tenir la nuit. (Ce passage m’a été relaté par mon père il y a
peu) Ma mère n’était pas présente, ou il n’en fait pas allusion. Mais
j’imagine qu’elle devait être terrassée par le chagrin, et qu’elle
n’ait pu se rendre à l’hôpital. Elle devait s’occuper de ma sœur qui
avait à peine un an. L’ambiance devait être un peu funèbre.
Le lendemain, mon père est venu pour prendre le document. Il repartira
sans. En effet, je ne suis pas encore décédé. Il faudra revenir demain…
Ambiance.
C'
est là que j’attrape la toxicose. Après trois mois
d’hospitalisation en soins intensifs à l'hôpital de Nimes, mon cas
est jugé désespéré. Il n’y a plus rien à faire. Aussi, les praticiens
décident d’arrêter tout traitement.
L’acharnement thérapeutique n’était pas encore de mise. Et c’était
très bien ainsi. Ça ne durera pas. Toujours est-il qu’à la suite
de cette décision, les médecins proposent à mon père de revenir le
lendemain pour récupérer le certificat de décès. En principe je ne
devrais pas tenir la nuit. (Ce passage m’a été relaté par mon père il y a
peu) Ma mère n’était pas présente, ou il n’en fait pas allusion. Mais
j’imagine qu’elle devait être terrassée par le chagrin, et qu’elle
n’ait pu se rendre à l’hôpital. Elle devait s’occuper de ma sœur qui
avait à peine un an. L’ambiance devait être un peu funèbre.
Le lendemain, mon père est venu pour prendre le document. Il repartira
sans. En effet, je ne suis pas encore décédé. Il faudra revenir demain…
Ambiance.

L e surlendemain bis repetita, suite à quoi, les médecins proposent de le joindre par téléphone dès que l’évènement se produira. Le coup de fil ne viendra pas. En effet, peu de jours après, mon état s’améliore, et l’année se termine, je suis considéré comme guéri. Comment ? Pourquoi ? Les médecins l’ignorent, mais le fait est. Mais pour tempérer la joie de mes parents, les praticiens ont précisé que suite à cette affection, je risquais d’importantes séquelles neurologiques… Ambiance encore. Suite à quoi, je considère que depuis, je fais du RAB …. L’année 1956 a dû se terminer en demi-teinte…
C
ourant 1957, mon père trouve un poste en Algérie. Mon frère y naît l'année suivante.
Dans un hôpital du quartier de Bab El Oued.
La famille a vécu à
 Kouba puis Bouzareah. l y a eu aussi des balades touristiques.
Et pour ce faire, toute la famille embarque à bord de la SIMCA
Kouba puis Bouzareah. l y a eu aussi des balades touristiques.
Et pour ce faire, toute la famille embarque à bord de la SIMCA

E n revanche, le passage à Ghardaïa L'hôtel et sa piscine je n'ai pas oublié. Sa piscine, surtout. Je me souviens que cette piscine possédait un accès avec quelques marches. Aussi, sur la première marche, j'ai pied. La seconde, j'ai encore pied. Arrivé à la troisième, c'est la surprise. Les yeux grands ouverts sous l'eau, et la tasse qui va avec. Je n'ai pas souvenir de qui m'a repêché. Il n'en reste pas moins que mon enthousiasme pour l'élément liquide a été momentanément rafraîchi.
R
etour à Alger et cette nouvelle résidence
 Alger Plage C’était une villa située à une centaine de mètres d’une plage. Ce qui, pour ma mère devait être plus parlant.
En effet pour une bretonne, la mer est importante.
Et de fait le dépaysement moins pénible. À moins d'une centaine de mètres de la plage, ce ne pouvait être mieux.
La plage, les jeux, cette tente et ce costume d'indien, offerts lors d'un Noël, je pense mais ne m'en souviens pas.
Ce voilier, il ne m'est revenu en mémoire qu'après avoir revu cette vidéo. Feu-Follet, ainsi avait-il été baptisé
De bombes, je me souviens aussi. Un soir d’hiver, je pense car il faisait déjà
nuit, au bout de la rue, à l’opposé de la plage dans une rue qui
longeait le littoral était située une épicerie. Un éclair dans la nuit.
Le lendemain parti avec ma mère faire les courses, je me souviens de la
boutique calcinée.
Alger Plage C’était une villa située à une centaine de mètres d’une plage. Ce qui, pour ma mère devait être plus parlant.
En effet pour une bretonne, la mer est importante.
Et de fait le dépaysement moins pénible. À moins d'une centaine de mètres de la plage, ce ne pouvait être mieux.
La plage, les jeux, cette tente et ce costume d'indien, offerts lors d'un Noël, je pense mais ne m'en souviens pas.
Ce voilier, il ne m'est revenu en mémoire qu'après avoir revu cette vidéo. Feu-Follet, ainsi avait-il été baptisé
De bombes, je me souviens aussi. Un soir d’hiver, je pense car il faisait déjà
nuit, au bout de la rue, à l’opposé de la plage dans une rue qui
longeait le littoral était située une épicerie. Un éclair dans la nuit.
Le lendemain parti avec ma mère faire les courses, je me souviens de la
boutique calcinée.
M on père en tant qu'officier de réserve était régulièrement rapellé dans des unités territoriale. Il entrainait ma mère à tirer au 6-35. Au cas où. Ce n’était pas son arme de service, l’arme de poing en service dans l’armée le mac50 était chambré en 9mm.
A
ussi de vacances en France. Je me souviens du calot bleu clair des
hôtesses de l’air, de la
caravelle. Et du
Breguet 2 ponts



E n partant de Marseille ou d'Alger, les traversées se font parfois par bateau J'en garde un souvenir très diffus. Ètait-ce à bord de ces navires ? C'est bien possible.
C hez ma grand-mère paternelle qui habitait à Paris, rue Saint Jacques entre la Sorbonne et le jardin du Luxembourg. Le grand bassin devant le palais où voguaient moult petits navires à voile. Un petit théâtre de marionnettes, des poneys placides que montaient les enfants. En 1960 ou 1961, à Alger, mon frère attrape la diphtérie. Je me souviens, sur une table à manger le trou rond dans la gorge pratiqué par le médecin. Je me souviens de l’ambulance militaire qui menait vers l’hôpital à Alger. Le chauffeur la MAT-49 à la portière.
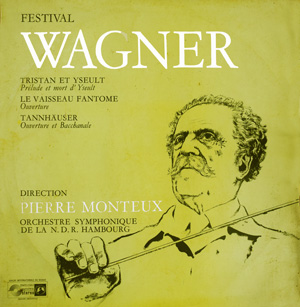
Tannhäuser de Wagner
que j’ai pu resituer
bien des années plus tard.
L' année1962 commence, les évènements pénibles et récurrents ont raison du moral de ma mère. L’alcool s’installe. Mon père rencontre une belle Kabyle. En octobre, avec le chat Plastic dans la soute, nous prenons l’avion pour rentrer à Paris. Mon père reste à Alger. Il y restera encore dix ans.

L à, la chronologie des évènements devient incertaine. Les choses se précipitent. Ma mère disparait de la circulation, et dans un premier temps, nous sommes confiés à une famille d’accueil dans les Yvelines. C’est là que j’ai reçu ma première gifle. Ce devait être aux alentours des fêtes de fin d’année. J’avais dans les mains un coutelas d’indien avec une lame en caoutchouc. Issu sans doute de la panoplie idoine. Du haut de mes bientôt six ans, j’ai voulu expliquer que, si la lame, du fait de sa composition était sans danger quant à son usage premier, par contre cela pouvait être douloureux si on l’utilise différemment. Et pour démontrer la justesse de mon raisonnement de prendre la main de la personne et de lui claquer cette lame sur le dos de la main. La réponse ne s’est pas fait attendre. Cette gifle, si je ne l’ai pas oubliée, je ne me souviens pas de ce que j’ai pu éprouver face à la violence de cette réaction. Mais bon, c’était à titre d’entrainement, de mise en bouche pour ce qui allait suivre.
E n effet, ma grand-mère paternelle trouve un pensionnat du coté de Lozère dans l’Essonne tenu par une dame certainement bien sous tous rapports. Elle nous est présentée en tant que « Tante Su » Elle se prénommait Suzanne Cette personne possédait une grande maison en pierre meulière face à la ligne de chemin de fer. Dans cette maison, un hall qui me paraissait immense et au fond un escalier en pierre de la même eau.
La méthode Montessori, La Pédagogie douce, il va falloir oublier.
J'
arrive dans un monde nouveau. Moi qui avais appris à manger dans une
assiette en porcelaine avec un couteau, une fourchette ou une cuillère,
boire dans un verre en verre, je découvre les gamelles et bol en
plastique et pour tout couvert une cuillère. Le matin, ce bol en
plastique rempli d’un brouet probablement chocolaté rempli d’ignobles
grumeaux qui ne devenait pas meilleur quand après un haut le cœur, je le
vomissais je devais avec force gifles le ravaler.
L’école avait lieu sur place. Tante Su, avait une pédagogie pour le
moins sommaire. Tu ne comprends pas, ne lis pas de suite, cela se
traduit immédiatement par des coups d’ardoise sur la tête agrémenté des
gifles réglementaires.
I l y avait les séances d’humiliations collectives. Dans le groupe de mômes, il y avait une gamine qui devait être passablement dérangée. J’entends par là qu’elle devait avoir des problèmes psychomoteurs. Elle marchait voutée et remuait constamment la tête. Un jour elle est prise à partie par Tante Su. Elle lui fixe un manche à balai dans le dos et lui passe les bras derrière par la faire se tenir droite. Ce ne devait pas être suffisant. L’intention n’a manifestement pas été comprise. La gamine n’avait pas su prendre la bonne position. Suite à quoi elle a dû faire une crise de nerf et est parti en vrille. Tante Su ne se laisse pas impressionner, attrape la môme la plaque sur ses genoux, la déculotte puis ordonne aux autres de se mettre en rang et chacun son tour de lui claquer les fesses. Je n’ai pas souvenir du résultat didactique de la manœuvre.
I l y avait aussi un môme qui faisait partie des petits. C’est-à-dire plus jeune que moi ; six ans à l’époque. Il devait avoir trois quatre ans. Il était couvert d’eczéma ou quelques choses d’approchant. Une peau recouverte de croutes. Un matin Tante Su donne un coup de balai en haut de l’escalier. Le gamin a la malchance de se trouver sur le chemin. Un coup de balai l’envoie débouler les marches et s’affaler dans le hall. Là aussi, ma mémoire fait arrêt sur image, je ne me souviens plus de la suite.
T ous les quinze jours environ, la grand-mère paternelle venait nous voir. Sans doute s’assurer que tout allait bien. Et manifestement tout allait pour le mieux. Mais, me direz-vous ; il eût été possible de se plaindre ? D’éprouver quelques rancœurs face à ces méthodes un peu expéditives ? Et donc en faire part ? Bien sûr ! Un jour de visite, ma sœur s’y est essayée. C’est elle qui m’a relaté ce passage trente ans après. L’objet de la plainte était pour le moins anodin. Elle s’est donc plainte de l’heure tardive à laquelle nous devions rester devant la télévision. La grand-mère écoute, puis se tourne vers Tante Su :
D ont acte. Merci madame, au revoir madame. La porte à peine fermée, ma sœur prend la raclée apte à la dissuader de toute médisance à l’égard de notre bienfaitrice. Un dessin n’aura pas été nécessaire pour comprendre ce qu’il ne vaut pas tenter.
À la fin de l’année, nous avons droit aux sports d’hiver. Tante Su ne recule devant rien pour assurer notre bonheur. Elle possède un chalet dans les Alpes. Je ne me souviens pas comment nous y sommes rendus. Par train probablement. La neige, c’est la seconde fois que j’en vois. La première, fois lorsque mes parents se sont rendu dans les Vosges rendre visite à des proches. J
e me souviens, Tante Su son balai à la main dans l’escalier (encore)
me surprend à rêver dans le vestibule. A portée de balai, je le prends
dans la figure suivi d’un ordre qui n’appelle aucune discussion, à
savoir mettre la fermeture éclair de l’anorak d’un petit. Ce faisant, en
me tournant vers un grand miroir placé sur un mur, me vois un filet de
sang coulant de la tempe vers la joue. Ce n’était pas l’hémorragie
heureusement sinon je risquais de tacher mon anorak.
J
e me souviens, Tante Su son balai à la main dans l’escalier (encore)
me surprend à rêver dans le vestibule. A portée de balai, je le prends
dans la figure suivi d’un ordre qui n’appelle aucune discussion, à
savoir mettre la fermeture éclair de l’anorak d’un petit. Ce faisant, en
me tournant vers un grand miroir placé sur un mur, me vois un filet de
sang coulant de la tempe vers la joue. Ce n’était pas l’hémorragie
heureusement sinon je risquais de tacher mon anorak.De retour à Lozère, les jours passent avec leurs lots de brimades. Je me souviens, les jours de bain dans le garage. En effet, dans ce garage qui devait servir de cave car aucune voiture ne s’y trouvait, il y avait une baignoire. Et dans ce garage, à la queue leu leu, nus, les gamins attendaient leur tour pour y être nettoyés. C’était assez désagréable, vu qu’il n’y avait pas de chauffage. Mon tour venant, j’ai dû regimber car de l’eau dans les yeux. La réponse a été immédiate, j’ai eu droit au jet d’eau dans la figure …
D ans le jardin, il y avait encore de la neige. Et je trouvais très beau cette dernière avant qu’elle ne soit souillée par les traces de pas qui ne manqueraient pas d’apparaître. Le printemps s’est installé. Les feuilles ont de nouveau paré les arbres et les fleurs orner les parterres. Je me souviens avoir pour la première fois entendu le chant du merle. Et depuis le chant de ce sympathique oiseau m’est pénible à entendre.



J e me souviens aussi que l’envie de voler n’était pas encore éteinte de transformer après moult découpages un chapeau de cow-boy en feutre en casque de pilote. Avec les lunettes taillées dans un morceau de carton avec de l’adhésif transparent faisant office de verres. Le dossier d’une petite chaise où j’avais dessiné les cadrans pour le tableau de bord de l’aéronef. Avec les lunettes taillées dans un morceau de carton avec de l’adhésif transparent faisant office de verres. Le dossier d’une petite chaise où j’avais dessiné les cadrans pour le tableau de bord de l’aéronef.

J e refais de nouveau connaissance avec l’école. Au départ, dans le pensionnat religieux où avait été placé ma sœur (Elle sera pensionnaire quasiment une dizaine d’année) J’ai voulu rester avec elle dans sa classe de cours préparatoire. Ça me passe au-dessus de la tête, j’ai d’autres soucis. Aussi, je suis ramené manu militari dans la classe de maternelle. Cris, révolte, rien n’y fait. Néanmoins, les enseignantes ont su faire et me rasséréner avec moult dessins et coloriages. Le cours préparatoire, je le fais dans une autre école. Une petite école religieuse aussi tenue par des frères Maristes. Dans ce petit établissement, deux femmes : la maitresse du cours préparatoire et la cuisinière. Il y avait quatre salles : le cours préparatoire avec une maîtresse., Les cours élémentaires 1ère et 2ème année avec un instituteur, les cours moyens 1ère et 2ème année avec un autre instituteur puis la classe de certificat d’études faite par le frère supérieur, directeur de l’établissement. Et un vieux religieux, le frère Séraphin professeur de dessin. J’y reviendrai.
L e cours préparatoire se passe bien, je passe en CE1. L’instituteur à blouse grise était connu pour hurler beaucoup. L’année précédente en CP, entendre les éclats de sa voix au travers la cloison n’avait rien de rassurant. Sur place, il a fallu faire avec. Le cheveu noir, l’air sévère. Il avait un stylo à quatre couleurs en fer dans la pochette de sa blouse. Je l’enviais pour cela. La classe était donc divisée en deux section ; les CE1 et les CE2. Cet instituteur avait la particularité après chaque classement mensuel de positionner les élèves en fonction de leur résultat. Et contrairement à ce qui devait se faire plaçait les premiers au fond de la classe. Les derniers, juste devant son pupitre. Ce qui somme toute est assez judicieux. Il gardait les plus faibles à portée de voix. D’entrée de jeux, j’ai eu la chance (ou le bon goût) de me placer d’emblée dans les premiers. Ce qui permettait d’être relativement à l’abri de ses hurlements. Comment ? Pourquoi restais-je bien noté ? Peut-être par nécessité. J’ai donc passé deux années scolaires avec cet homme. Je n’ai jamais eu de discussions avec. Sinon devant son bureau pour réciter les tables de multiplications. Les cours de dessin dispensés par le frère Séraphin étaient une détente, une évasion. Et je m’en sortais bien. Plus tard, j’ai appris qu’il avait voulu m’initier à la peinture et à l’aquarelle. Il est décédé avant. J’ai assisté à ses obsèques en forêt de Brocéliande.
P uis vient le Cours moyen (CM1) Là l’instituteur était plus classique, plus académique. Je n’y ai fait qu’un trimestre. je n'aurais donc pas l'occasion de profiter de son classicisme En effet, ma mère s’est fait attribuer un logement HLM dans la banlieue de Rennes.

D' où changement d’école. Mais cette fois, l’école communale et laïque. Pourquoi ? Parce-que ma mère a pu prendre contact avec son futur ex beau-père qui vivait à Mougins à quelques kilomètres de Cannes. Celui-ci ayant coupé toutes relations avec son fils sur un différend familial sur la génération précédente. Mon père était aussi enfant du divorce. Donc Pourquoi l’école laïque ? Parce que s’étant proposé de financer nos études et en tant que libre penseur, l’enseignement religieux ne lui paraissait pas pertinent. Mais voilà, les programmes de la communale sont plus avancés que ceux de la petite école religieuse. D'autant que j'arrive dans cette classe en cours d'année. Au second trimestre. Vais-rattraper le retard en prenant l’année en cours au second trimestre ? Sinon il me va falloir redoubler. Ce ne sera pas nécessaire. D’emblée, je suis classé dans le premier tiers de la classe. Comment ? Je ne sais.
À la maison, ma mère déprime de plus en plus. Elle passe des nuits entières à rédiger à la machine des plaidoiries relatives au divorce qui se traine. Si les premiers temps elle a pu tant bien que mal tenir la maison cela s’est progressivement dégradé. Ma mère n’a plus ni moral ni énergie. Les devoirs à la maison passent à la trappe. Le matin, il faut se réveiller par soi-même pour être à l’heure en classe. Je me souviens qu’elle nous avait inscrits au catéchisme. Sa culture Bretonne était très présente. Aussi, le mercredi soir, il fallait se rendre chez une jeune femme qui avait pour rôle de préparer les enfants à la séance de « caté » du jeudi matin. Pour ce faire, il fallait avoir appris les questions et réponses d’un manuel de formation religieuse. Déjà peu porté sur la chose, il me fallait néanmoins réciter ce que je devais avoir appris par cœur la veille. Ce que je ne faisais pas. Aussi je retenais le nécessaire quand nous était donné un court moment pour réviser. Aussi je m’en sortais à chaque fois.E n classe, ça se passait relativement bien. Sauf une fois après que l’instituteur eût corrigé les rédactions du cours de français, m’appelle à son bureau. Là, paternellement me demande si j’ai copié sur un livre pour rédiger ma rédaction. Stupeur de ma part, mais pas de réactions visibles. Il m’avait été dit qu’il fallait beaucoup lire pour bien écrire. Ce que j’avais fait. Le résultat a dû dépasser les objectifs. Donc si se souvenir des livres lus pour apprendre à tourner ses phrases, c’est copier ; Alors oui j’ai copié. L’incident ne s’est pas reproduit. Sans doute ai-je adapté ma prose plus en phase avec le niveau scolaire qui doit-être le miens. À l’avenir, ce sera donc service minimum.
P énibles les cours de sport ou de gymnastique, je suis tenu de faire du football. Je fais donc semblant. Jusqu’au moment où je ne ferai plus semblant. Les vacances se passaient en deux temps: un mois à Mougins, et un mois en colonies de vacances. La Colo grande formatrice de vie en troupeau. J'en veux pour preuve ces anecdotes:
C'
est dans un établissement de vacances près de Saint Malo que
je fais connaissance avec le système.
Cette petite colonie de vacance avait ses locaux dans l'enceinte d'un
établissement scolaire. Avec une cours, un préau et des marroniers. La
plage n'était pas loin. On s'y rendait en rang par deux les plus grands
devant. Je n'ai pas souvenir des encadrants.
la seule chose qu'il me reste quant à la vie courante est ceci:
Dans la pièce dédiée aux occupations manuelles et(ou) créative qui, le
reste de l'année devait être une salle de classe, j'errait sans buts
précis, lorsque je remarque sur une table un cachet pharmaceutique,
vraisemblablement de l'aspirine. Le cachet dûment emballé dans un petit étuit de
célophane rose.
Ce cachet à la vue de tous peut interesser n'importe qui. Et par
n'importe qui, ce pouvait être quelqu'un des petits. Et ce petit de
considérer ce cachet comme un bonbon. Et de fait, s'empoisonner. Tel
était mon raisonnement. Aussi, pour éviter un drame, je m'emparre de
l'objet, le jette à terre, et méticulesement le réduit en poussière.
Mal m'en prends, un gamin me surprend et s'enquiert de ma manoeuvre. je
lui explique. Et suite à quoi il menace de révéler mon action auprès
des autorités compétentes. Á savoir les monitrices en charge de la
sécurité des mômes.

C ela a dû être un cri du cœur. L'idée d'être convaincu d'un tel crime me fait perdre tout le restant de jugement que je pouvait encore avoir. Résultat des courses, le petit fumier, car il était plus petit que moi. Et rouquin de surcroit, menace de révéler ma forfaiture si au départ pour la plage, au moment de se mettre en rang, je refuse de le voir se mettre à mes côtés avec les plus grands.
E t jusqu'à la fin du séjour, lors du départ vers la plage, lorsque les rangs se forment, le petit fumier de se précipiter près de moi, et de sa petite taille, me fixe et me susurre:
E t moi déséspéré, j'obtempère. La fin du séjour a été une délivrance. L'année suivante, de nouveau la colonie de vacances. Mais cette fois, au sein d'un autre organisme. Dans cette colonie située près de Saint-Malo les mômes étaient identifiés par sexe et groupe d'âge avec un foulard de couleur. Chaque jour, chaque groupe était dédié à une activité. Un jour, j'ai été surpris à glander seul, à rêver, sans doute. Mal m'en a pris. Un moniteur s'est rué sur moi, m'attrape par le foulard, me secoue vigoureusement, me demande en hurlant où se trouve mon équipe. D'une main je lui désigne son emplacement probable. Il me relâche et m'ordonne de courir la rejoindre. Je m’exécute. Sans doute le garçon était-il tenu de faire respecter des consignes de sécurité. Mais il ne lui était sans doute pas interdit de me le signifier gentiment. Cet évènement a participé entre autres à mon peu d’empressement à la jouer collectif. Tare inadmissible de nos jours. Mais c’est ainsi. L’école primaire se termine, je suis admis en sixième avec ce commentaire de l'instituteur

P
our l'entrée en 6
E n l’apprenant; je lui ferai chèrement payer ce choix quelques années plus tard en rompant tout contact avec elle pendant près de dix ans. Elle ne méritait pas ça. Il y avait aussi ce magistrat militaire qui en pinçait pour elle. Il a été reconduit parce qu’il envisageait de nous mettre en pension. Trop dur pour ma mère. Elle pensait encore trop à mon père.

C e petit collège fraichement construit. Et pas encore terminé ouvre ses portes. La tenue réglementaire est la blouse. Deux blouses. Bleu marine pour les garçons, bleu clair et beige clair pour les filles. Et le nom brodé en rouge au-dessus de la pochette. Sur mon unique blouse bleue, ma mère inscrit mon nom grossièrement en bâton. Elle n’a jamais aimé coudre. Le matin, il faut maintenant trouver les clefs pour quitter l’appartement pour aller au collège. En effet, le matin, ma mère dort encore et garde la porte fermée. L’année scolaire avance, ma blouse montre des signes de fatigue, les coutures se défont. Mes résultats scolaires font de même. Je suis admis de justesse en cinquième.
J e ne m’étendrai pas sur les fêtes de fin d’année. Ces quelques jours officiellement consacrés à la famille et à la joie, prenaient à la maison une coloration particulièrement sinistre voire funèbre. En effet, ma mère isolée de sa famille et hantée par la fin catastrophique de son couple, devant ce pauvre sapin misérablement décoré nous offrir de tristes présents en pleurant. Depuis, j’éprouve une solide aversion pour ces évènements. Même si par la suite, lors de mes expériences conjugales successives (Et systématiquement toxiques) j’ai dû en repasser par là. Mais mentalement j’étais ailleurs.
E n cinquième, c’est l’ effondrement. Je ne comprends plus rien. En mathématiques, comme dans les autres matières d’ailleurs, mes notes tendent vers zéro. En cours d’année, le professeur de mathématiques, au vu des résultats catastrophiques prend la peine de jeter un œil sur mes cahiers. Ou du moins ce qui devaient être considérés comme tels. A la vue du foutoir complet qui s’offre à sa vue, il se contente de me coller une gifle cinglante, puis tourne les talons, continuer son cours. Ce sera le seul échange que j’aurai avec les professeurs. Je sens que tout craque. Mais que faire ? J’ai eu droit à passer des tests d’orientation ou d'efficience intellectuelle. Avec entre autres ranger des cubes dans un ordre donné. Humilié, je m’exécute d’une main. Tu peux utiliser tes deux mains me dit suavement la professionnelle de l’orientation. Humiliation supplémentaire. Suis-je trop con pour ne pouvoir faire cette activité imbécile d’une main ?

 L'établissement au sein duquel ma scolarité a sombré.
L'établissement au sein duquel ma scolarité a sombré.
J e ne connaitrai pas les résultats, en fin d’année, je passe en classe poubelle. J’en ai ravalé mes larmes. Il ne me restait que cela. Je n’avais rien à attendre des adultes. Mais pour cacher à mon grand-père paternel mon naufrage scolaire, il m’a été donné de passer le « certificat d’études » A l’époque, c’était déjà devenu optionnel, voire symbolique. Je passe donc cette formalité, et peux, aux vacances à Mougins exhiber ce papier aux yeux satisfaits de mon aïeul.

C ette classe « poubelle » poliment désignée 4ème Pratique dirigée par un instituteur trentenaire à la fibre ouvrière bien ancrée. Complètement à l’opposé de la directrice de l’établissement que l’on voyait apparaitre en hiver la mise en pli soignée et manteau de fourrure. était composée de gamins considérés comme inaptes à la culture générale et de débiles légers. Je touchais le fond. Je me souviens d’un gamin un peu limité mais qui possédait pleins d’autocollants relatifs à un spiritueux Son géniteur devait œuvrer dans cette maison. Aussi, j’échangeais mes résultats d’exercices de calcul contre ces objets. Pour décorer mon vélo. 1968 avait déjà deux ans, et les premiers délires pédagogiques ont commencé à sévir. Et les notes classifiées en cinq lettres. Pas de mauvaises pensées, ces cinq lettres allaient de A à E. Aussi, je me sentais vexé. « A » était trop près de « E »
J e me souviens aussi lors des cours de travaux manuels (Pour lesquels je n’ai jamais brillé) Il fallait fabriquer une boite en bois. Pour quel usage ? Je ne m’en souviens pas. Toujours est-il que les morceaux de bois nécessaires à son élaboration, il fallait les scier correctement. Ce que je n’ai pas su faire. Je n’ai guère fait de progrès depuis. Aussi, pour ne pas insulter l’avenir, j’échange subrepticement mes morceaux de bois mal taillés contre ceux, biens ouvragés d’un gamin au potentiel intellectuel très limité. Je considérais qu’il n’avait rien à perdre, moi si. Je cloue donc rapidement son œuvre sur mon bricolage. Au final, ce dernier passe à peu près correctement. Quant à ma victime, elle se fait copieusement allumer par l’instituteur pour ce travail « salopé » Le garçon n’a rien compris. Cruel, mais pour moi, c’était vital.
L es séances d'éducation physique étaient, contrairement aux classes dites "Normales" assurées par ce même instituteur. Un enseignant dédié était peut-être de trop pour l'engeance qui peuplait les classes "pratiques" et de "transition" Résultat des courses, ces cours de "gym" se résumaient invariablement à du football. Et ce, pendant une heure. Aux débuts, j'ai tenté de faire preuve de bonne volonté. Mais dans ce domaine, comme dans celui du "manuel" je n'ai pas brillé. Suite à quoi, j'ai définitivement laissé tomber. Et, de fait, me suis fait violence à faire un bras d'honneur à l'injonction de jouer. En effet, mon côté foncièrement légaliste m'interdisait pareille révolte. Aussi, "trop, c'est trop" j'ai outrepassé mes censures personnelles et me suis allongé au bord du terrain attendre la fin de l'heure. Á l'étonnement de l'instituteur qui ne devait pas comprendre ne pas priser cette activité. Mais c'est ainsi.
À cette époque, en fouillant ce qui restait de la bibliothèque de ma mère, je découvre Erskine caldwell. Un contemporain de John Steinbeck avec l’ironie en plus. La noirceur et la sensualité un peu glauque tranchaient avec la prose convenue de ces livres pour la jeunesse que j’avais lus par le passé. Je suis tombé aussi sur cet ouvrage. J’avais bien aimé. Je ne me livrerai pas à une exégèse de ces ouvrages, ce n’est pas le sujet. Néanmoins, cela m’a amené plus tard à trouver plaisir à lire des auteurs que mon niveau « culturel » officiel ne me prédestinait pas. Il n'en reste pas moins qu'entre ces deux extrèmes il y a eu ces bouquins qui longtemps m'ont fait regretter d'être né trop tard.




L a fin de l’année scolaire se termine par mon admission dans un établissement appelé « Collège d’enseignement technique » pour préparer en trois ans un parchemin joliment nommé Certificat d’aptitude professionnelle en mécanique. Super ! Je ne l’ai jamais souhaité. Mais que des gens bien intentionnés ont cru bon pour moi. Je ne me souviens pas avoir passé des tests d'aptitudes aptes à vérifier si j'ai le profil pour éxercer cette activité. je dois d'emblée l'avoir.
Avec deux d’entre eux, à vélo, nous errons dans la banlieue Rennaise à la "recherche de gonzesses". Hé oui, à cet âge, les hormones travaillent. Nous sommes en Juillet, il fait chaud, les rues sont désertes. C’est désespérant. Un de mes acolytes n’est pas du genre à se faire des nœuds au cerveau. Il le prouve une première fois lors d’une rencontre avec des gamines dans une campagne environnante. Il jette son dévolu sur l’une d’elles, à moins que ce ne soit l’inverse. Et à l’ombre d’une haie entreprend de faire ce qu’il y avait à faire en pareil cas. L’autre collègue plus réservé également et moi, de faire acte de présence. Á ce moment est passé un homme âgé peut-être la cinquantaine s’indigner de voir les deux mômes enlacés se «rouler des pelles» à qui mieux mieux. Et de s’esclaffer, indigné:
Et le collègue pas démonté de lui répliquer :
Et de retourner à sa besogne. L’échange n’a pas dû aller plus loin. L’indignation a submergé le vieux. Et a continué son chemin. Une autre fois, au pied d’une barre d’immeuble, nouvelle rencontre. Cette fois-ci, c’est sur moi que la gamine jette son dévolu. Je n’y croyais plus. Mais tout arrive. Nous sommes allés vers les prés environnants. Á cette époque c’était encore courant. Suivi des deux collègues beaux joueurs. Je l’ai prise par la main, elle me la donne. Marché un moment. Et moi de me demander quand va-t-elle se décider ? Sans réaction de sa part, je n’ose rien. Je n’ai rien osé.
Résultat des courses, c’est vers le collègue plus hardi qu’elle s’est retournée. Et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, à sa plus grande satisfaction, l’a retournée derrière une haie.
Et moi de faire garniture… Je m’en suis voulu...
L’
établissement était situé en centre-ville. Le
 bâtiment était ancien, respirait la formation professionnelle des futurs vaillants ouvriers de l’industrie des années
1950.
Seule l’aile abritant les ateliers avec leurs
bâtiment était ancien, respirait la formation professionnelle des futurs vaillants ouvriers de l’industrie des années
1950.
Seule l’aile abritant les ateliers avec leurs
 machines-outils était de facture plus récente.
Les classes dédiées à l’enseignement dit « général » étaient à niveau.
Comme des petits amphis. Cela me plaisait bien. Le professeur de
mathématiques était une espèce de professeur Nimbus qui faisait son
cours à toute vitesse. Noircissait (à la craie blanche) le tableau de
ses démonstrations, puis au bout d’une heure (les cours duraient deux
heures) passait à l’interrogation écrite. La plupart des élèves
coulaient. Un peu plus de pédagogie eût été plus adaptée à leur cas.
machines-outils était de facture plus récente.
Les classes dédiées à l’enseignement dit « général » étaient à niveau.
Comme des petits amphis. Cela me plaisait bien. Le professeur de
mathématiques était une espèce de professeur Nimbus qui faisait son
cours à toute vitesse. Noircissait (à la craie blanche) le tableau de
ses démonstrations, puis au bout d’une heure (les cours duraient deux
heures) passait à l’interrogation écrite. La plupart des élèves
coulaient. Un peu plus de pédagogie eût été plus adaptée à leur cas.
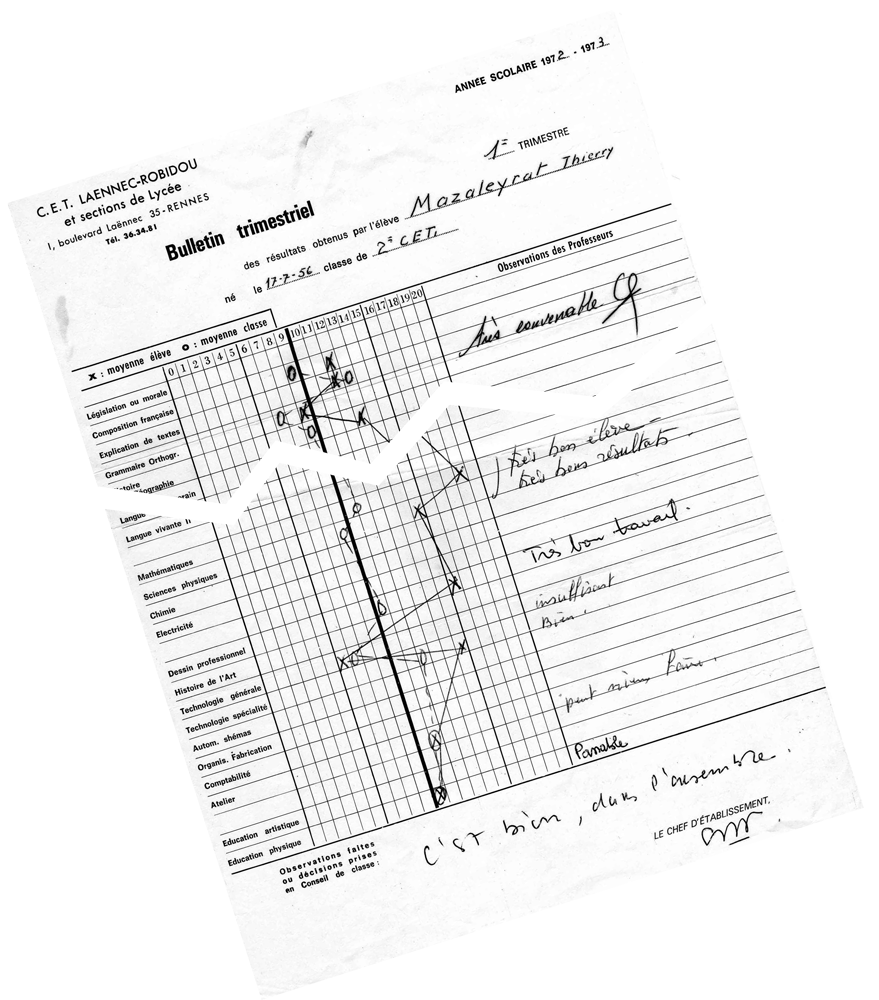 Mais bon, c’était l’époque. Je m’en sortais avec d'honnêtes
moyennes.
Comment je faisais ? Je ne m’en souviens pas. Ce n’est pas avec les devoirs à la maison que je ne prenais pas le
temps de faire. Cela faisait bien longtemps que j’avais oublié cette pratique. Ma mère était depuis longtemps dépassée.
Mais bon, c’était l’époque. Je m’en sortais avec d'honnêtes
moyennes.
Comment je faisais ? Je ne m’en souviens pas. Ce n’est pas avec les devoirs à la maison que je ne prenais pas le
temps de faire. Cela faisait bien longtemps que j’avais oublié cette pratique. Ma mère était depuis longtemps dépassée.
I l y avait un élève qui faisait encore mieux. On l’appelait « Frisette » il était roux et frisé. Il était de l’assistance publique. Ce gamin, orphelin donc possédait une improbable « Mobylette » trafiquée par ses soins. Et de fait arrivait en cours régulièrement une heure en retard. Aussi, lorsque les cours de mathématiques avaient lieu de huit heures à dix heures. Il arrivait vers neuf heures, à la fin de la démonstration les mains couvertes de cambouis. Juste avant l’interro. Le temps de rejoindre sa place, il parcourait d’un œil le tableau et, In fine, terminait comme moi. Nous avons implicitement sympathisé. Et lors des parties de belotte, en salle des élèves nous avions mis au point des codes pour tricher et optimiser les chances de gagner.
I l y avait aussi le professeur de français-Histoire/Géo. C’était un autre genre. Un monsieur grand, carré, le costume bien coupé, la coiffure soignée. J’avais remarqué sur le revers de son veston le petit insigne de troupes aéroportées. Ce devait être un ancien militaire. Sa personnalité me plaisait bien. Il émanait de cet homme une espèce d’autorité teintée d’ironie. Et lorsqu’il rendait les copies, venant mon tour, pose son regard sévère sur moi, un temps d’arrêt, prend ma copie dit « Mazaleyrat, comme d’habitude ! » Tétanisé, je me recroqueville en me demandant ce que j’ai bien pu foirer. « Très bien » me dit-il en déposant ma feuille sur mon pupitre. Pour les devoirs de rédaction, je n’ai jamais été soupçonné de pomper sur des ouvrages existants…
L ors des séances dites professionnelles, ça a été un autre registre. En début d’année, l’un des professeurs fait un cours sur la sécurité. En effet, ces machines outil destinées à usiner des morceaux de fer étaient potentiellement dangereuses à défaut de précautions indispensables. A l’époque, la mode était aux cheveux longs. Pour ma part, comme beaucoup d’autres, je les portais sur les épaules. Et de fait il fallait porter une espèce de résille sur la tête pour retenir les cheveux. Et les manches de bleu de travail correctement boutonnées. Parce que, disait cet enseignant, il est arrivé des accidents avec des gens scalpés par les machines pour avoir laissé trainer sa chevelure sur les trucs qui tournaient. Ou le bras arraché pour avoir laissé trainer un bout de manche à portée des dents de la machine. Suite à quoi, dans cette tenue ridicule, mon seul souci a été de ne pas trop m’approcher de ces engins. Ce que la machine pouvait faire, je m’en foutais éperdument, mon intégrité physique passait avant tout. Même si aux tout débuts, j’ai essayé de m’appliquer. Mais mon modus operandi et ma motivation étant, les résultats étaient très moyens. Voire pires … J’ai été admis en deuxième année. Ce sont les mêmes professeurs qui président à cette nouvelle année. Le professeur de mathématiques un jour me suggère de reprendre un baccalauréat technique à l’issue des trois années, le certificat d’aptitude professionnelle en poche. Je n’ai pas décliné, mais encore fallait-il tenir jusque-là.
À la maison, ma mère est semée, elle passe la main à un service social. Et je suis présenté à l’assistante sociale. Suite à quoi, dans un premier temps l’internat m’est proposé (ou imposé) Après les fêtes, me voilà pensionnaire. Il n’y avait qu’un garçon de ma classe qui avait ce statut. Les autres étaient élèves en BEP ; le niveau supérieur… Et en tant que pensionnaire, après ou avant le diner (je ne me souviens pas), il y avait une ou deux heures d'études consacrées aux devoirs. Dans le local d’étude, il y avait des tables de cinq ou six places. A l’une de ces tables, moi, mon camarade de classe et trois ou quatre élèves en BEP. Ils étaient tous très sérieux et c’est avec beaucoup d’application qu’ils se livraient à leurs travaux du soir. Moi pas. Mes cahiers restaient constamment fermés. J’attendais que ça se passe. Je me souviens qu’un soir d’étude, devant mon persistant refus d’ouvrir un cahier, un garçon de BEP demande alors à mon camarade d’étude si j’étais le représentant des cancres de la classe. Non, répond-il, c’est le premier… Je me souviens avoir éprouvé une ironique satisfaction devant le regard étonné du questionneur.L e second trimestre arrive, ma répugnance à l'égard des machines atteint des sommets. Je fais n’importe quoi. Pour autant que je ne me mette pas en danger… Un matin au début d’une journée d’atelier après avoir revêtu ma tenue de travail, j’ai été pris d’une crise qui pourrait être de l'asthme. Je ne pouvais plus respirer. C’était terrible, je me sentais étouffer. Aussi, en économisant mes geste, pendant que les autres rassemblaient leurs outils, je me débarrasse de mon bleu, et sans rien demander quitte l’atelier, traverse la cour, passe la sortie et rentre chez moi. Il était pour moi hors de question d’aller voir un responsable. Je craignais de devoir me justifier, remplir des formulaires et attendre les décisions à mon égard. Je me sentais crever, je n'avais pas le temps, j’étais trop affaibli pour passer sous ces fourches Caudines. Ces craintes étaient sans doute sans fondement, mais ma confiance envers les adultes étant, je ne voulais prendre aucun risque. Peut-être quinze jours après, de nouveau sur pied, je retourne en cours. Je ne me souviens pas si j’ai été questionné.
J
e n’avais pas de
Mobylette, aussi, après avoir fait le tour des
garages à vélos des immeubles alentour, j’ai porté mon dévolu sur un
engin qui paraissait peu utilisé, avec un siège biplace ; le top. Je le
sors dans la rue, scie l’antivol, la démarre, et rentre chez moi.

T
oujours est-il qu’avant la fin du second trimestre, je déserte
l’école. Sur les conseils d’un camarade de classe, je me fais recruter
comme laveur de carreaux dans une petite entreprise de nettoyage.
Et entre deux coups de serpillère dans les locaux d’une banque et de
raclette sur les vitres d’un établissement quelconque, je passe chercher
à la caserne du quartier les formulaires pour m’engager dans
la Royale.
 Pourquoi la Royale ? Alors que mon désir était de voler ? La logique eût
été de choisir l’armée de l’air. Mais vu mon profil, c’eût été comme un
eunuque recruté dans un bordel… Dans la Marine, j’avais au moins
quelques chances d’être embarqué à bord d’unités opérationnelles. Et
puis, j’avais quelques références maritimes dans la
famille.
Pourquoi la Royale ? Alors que mon désir était de voler ? La logique eût
été de choisir l’armée de l’air. Mais vu mon profil, c’eût été comme un
eunuque recruté dans un bordel… Dans la Marine, j’avais au moins
quelques chances d’être embarqué à bord d’unités opérationnelles. Et
puis, j’avais quelques références maritimes dans la
famille.
 Je n’ai donc pas eu de mal à faire signer les documents par ma mère. Je suis
convoqué très rapidement pour faire mes « trois jours » à Guingamp. Là,
plein de tests physiques, mentaux. Puis à la question du temps
d’engagement. Trois ans ? Cinq ans ? Ce sera cinq ans. Je dois avouer,
que suite au handicap de mon œil j'ai dû tricher. Parfois, la fin
justifie les moyens ...
Je n’ai donc pas eu de mal à faire signer les documents par ma mère. Je suis
convoqué très rapidement pour faire mes « trois jours » à Guingamp. Là,
plein de tests physiques, mentaux. Puis à la question du temps
d’engagement. Trois ans ? Cinq ans ? Ce sera cinq ans. Je dois avouer,
que suite au handicap de mon œil j'ai dû tricher. Parfois, la fin
justifie les moyens ...
D e retour à Rennes, Je passerai encore quelques mois avec mes instruments de lavage. Mes loisirs se passent dans la banlieue à proximité du domicile maternel. Entre une «maison de jeunes» et un troquet de quartier. Entre beuveries et bagarres. L’été est arrivé, je vais avoir dix-sept ans. L’appel tarde à venir. Le temps me semble bien long. A l’issue des « trois jours », il m’avait été dit que je partirai très rapidement. Je suis toujours suivi « socialement » L’assistante sociale très imbibée « 68 » voit mon choix d’un mauvais œil. L’armée ce n’est pas bien. C’est fait pour tuer les gens ! Fort bien, et alors ? Fidèle à mon ressenti vis à vis des adultes, je crois n’avoir rien répliqué. Sans doute pas découragée, ma « protectrice » me fait inscrire dans une formation de pré-FPA. Louable décision pour ne pas me laisser sans formation. Pas contrariant, j’intègre l’organisme. Je me retrouve donc, une fois de plus dans un contexte de gamins en difficulté. A réapprendre à lire, à compter, puis couper des morceaux de bois, plier des tôles, faire du ciment et autres activités de la même farine ad nauseam. Je déserte de nouveau. Le responsable de formation arrive à me joindre au téléphone pour me convaincre de ne pas abandonner. Peine perdue, je suis fatigué de ces activités manuelles.
F
in octobre je suis convoqué à la caserne chercher ma feuille de
route. Je devrai être à la gare de Rennes pour un train en partance pour
Bordeaux le cinq novembre. Très tôt,
le lendemain le train arrive à Bordeaux où un car nous attend pour
rejoindre
Hourtin.
 Pendant les
classes, entre initiation à la vie militaire, de marche au
pas le fusil à l’épaule, je passe moult tests et à l’issue de ces
derniers, l’officier orienteur me demande ce qu’il me plairait de faire.
Je n’en ai aucune idée. Aussi bien conscient de mon niveau Bac-4, je suggère de faire
Fusillier-marin.
Pendant les
classes, entre initiation à la vie militaire, de marche au
pas le fusil à l’épaule, je passe moult tests et à l’issue de ces
derniers, l’officier orienteur me demande ce qu’il me plairait de faire.
Je n’en ai aucune idée. Aussi bien conscient de mon niveau Bac-4, je suggère de faire
Fusillier-marin.
 Me faisant comprendre que je peux
faire autre chose, lui répond alors « tout sauf la mécanique ». Il me
propose l’acoustique. En clair les sonars. J’accepte. Il aurait pu me
proposer cuisinier ou bosco. Ça n’a pas été le cas. Et c’est très bien ainsi. Peut-être la marine avait-elle un urgent besoin de
(Détecteur anti sous-marins)
Me faisant comprendre que je peux
faire autre chose, lui répond alors « tout sauf la mécanique ». Il me
propose l’acoustique. En clair les sonars. J’accepte. Il aurait pu me
proposer cuisinier ou bosco. Ça n’a pas été le cas. Et c’est très bien ainsi. Peut-être la marine avait-elle un urgent besoin de
(Détecteur anti sous-marins)
 Il y a eu aussi le TABDT. On ne sort pas d’une caserne sans ce vaccin. Á
l’époque, ce dernier était assez violent. Je ne sais pas ce qu’il en estè
de nos jours.
Il fallait au moins 24 heures pour récupérer après l’injection. D’où la
perspective de pouvoir glander une journée.
Il y a eu aussi le TABDT. On ne sort pas d’une caserne sans ce vaccin. Á
l’époque, ce dernier était assez violent. Je ne sais pas ce qu’il en estè
de nos jours.
Il fallait au moins 24 heures pour récupérer après l’injection. D’où la
perspective de pouvoir glander une journée.
J e n’ai pas de souvenirs quant à la suite immédiate de l’événement. Seulement, dans une autre pièce de l’infirmerie, assis sur une chaise, un infirmier me recoud l’entaille provoquée par cette ou ces dent(s). Et de terminer son ouvrage en attachant une compresse avec le restant de fil de la suture. Du coup, me voilà passablement handicapé. En effet, si un rigolo se prenait l’idée de m’enlever l’élégant pompon blanc qui me sert dorénavant de coiffure, les travaux de couture partiront avec. Ordre m’est donné de rejoindre ma chambrée avec une dispense de porter mon bâchi pendant quelques jours. Quant au vaccin, il est reporté de 24 heures. Dans la chambrée, il règne un calme singulier. Les effets du vaccin commencent à se faire sentir. Le lendemain, je retourne à l’infirmerie prendre ma dose. De retour dans la chambrée, les collègues ont commencé à reprendre du poil de la bête. Et de commencer à s’agiter. Et les oreillers et polochons de voler partout. Et moi qui commence à faiblir, de me réfugier sous un lit la main sur mon pansement. Et d’éprouver ce sentiment de solitude quand on se trouve en situation d’infériorité dangereuse. Je ne me souviens pas d’avoir eu la moindre remarque quant à ma mésaventure. Ni des chefs, ni des collègues. Début décembre les gens sont répartis dans différents cars. Les uns pour Lorient (Les futurs saccos), Cherbourg (les futurs fourriers) et Saint Mandrier près de Toulon(pour les artilleurs, détecteurs surface, sous la mer)
L a promo dans laquelle je suis intégré est constituée de gens de niveau terminale/Bac. Le plus faible (si tant est que l’on puisse utiliser cette expression) sortait de seconde. Alors moi, avec mon niveau de cinquième en vrille… Le premier mois, j’ai ramé (c’était une bonne entrée en matière pour la Marine). Les cours de physique et de mathématiques (tronc commun) ont été une rude découverte. Heureusement pour moi, un collègue (qui, je pense a dû faire une brillante carrière dans la Royale) m’a aidé à apprendre à résoudre des équations lors des heures d’études le soir entre dix-huit heures et vingt heures (c’était une école militaire). Je lui en suis encore reconnaissant. La formation sur les sonars a été plus facile. En effet, je partais sur un pied d’égalité avec mes camarades.

D
ans le cadre d'une école militaire, les permissions n'étaient accordées
qu'en cas de notes correctes aux multiples contrôles. Aussi quand j'en
avais la possibilité,
je me rendais chez mon grand-père paternel et son épouse à
Mougins.
 Son épouse, sa deuxième femme; le divorce est une tradition. En rentrant à Toulon le dimanche soir, Betty,
c'est ainsi qu'elle se nommait, glissait dans mon sac un paquet de
gateaux. Action anodine s'il en est, mais inoubliable. Je n'ai pas été
habitué à ce genre d'attention. Sans compter mon treillis lavé et
repassé.
Son épouse, sa deuxième femme; le divorce est une tradition. En rentrant à Toulon le dimanche soir, Betty,
c'est ainsi qu'elle se nommait, glissait dans mon sac un paquet de
gateaux. Action anodine s'il en est, mais inoubliable. Je n'ai pas été
habitué à ce genre d'attention. Sans compter mon treillis lavé et
repassé.
À la même époque, mon grand-père a souhaité me faire tirer le portrait en uniforme. Pour ce faire, un samedi, nous sommes descendus à Cannes faire le cliché. Je l'ai longtemps trouvé académique, voire pompeux. Mais pouvait-il en être autrement ?

I n fine, je termine dans la première moitié du classement. Après quoi chacun en fonction de son classement choisi son affectation. J’ai opté pour le Vauquelin. Pourquoi le Vauquelin ? Je ne sais plus. Toujours est-il que les escorteurs ASM avaient de la gueule. J’ai évité les escorteurs rapides. J’en avais un mauvais souvenir suite à une journée à la mer dans le cadre de la formation. Ce jour, la Méditerranée s’est progressivement creusée, et comme quelques autres, j’avais viré au vert …


J 'ai quitté la Royale pour deux raisons et demi.

La première raison : Malgré que l'officier chef du service ASM m'eût inscrit d'office au "Cours de Choufs" j’ai eu peur de me faire coincer lors du retour à Saint Mandrier.
Gamin, j’ai quasiment perdu un œil, (en cela, j’ai dû tricher lors de la visite médicale d’incorporation) Et cette conviction de ne pas être à la hauteur, ne pas avoir le niveau. et donc de me planter lamentablement a été un facteur supplémentaire à cette décision.
La deuxième raison : 1968 était encore très proche. Aussi, que ne m’a-t-on seriné que le civil c’est mieux. Je n’en ai jamais été persuadé, mais j’ai cédé.
La raison et demie : Rester dans le corps des équipages me pesait un peu. Je voulais faire officier. Cela eût pris du temps, mais faisable sans mon problème d’œil. Au retour à la vie civile, ne sachant que faire, la Marine m'a permis une formation de calculateur en charpente métallique. J'ai fait ce choix à défaut d'autres. Je n'ai jamais exercé ce métier. Le temps passant, éviter de la jouer Gribouille et faire second-maître et maître n'eût pas été honteux.

U
n parent m’a fait entrer dans un cabinet d’études sous-traitant de
la société au sein de laquelle il œuvrait.
Et pour l'occasion, m'offrit ma première
calculatrice programmable. Je lui suis encore reconaissant pour m'avoir mis le pied à l'étrier
(Expression qui prendra tout son sens quelques
années plus tard) pour le codage informatique. Mais je n'en ai pris vraiment conscience que bien
plus tard.
 Je me suis donc retrouvé à faire du
dessin industriel. C’est moins pire que de limer des morceaux de ferraille.
Je me suis donc retrouvé à faire du
dessin industriel. C’est moins pire que de limer des morceaux de ferraille.

J' ai rapidement vu à quoi ressemblait le civil que l’on m’avait tant vanté. Je ne m’étendrai pas sur mon ressenti. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Comme il est convenu de dire. Reste qu'un jour, mon patron vient me voir et me demande si je fais partie d'une secte. Étonnement de ma part. Et lui de me faire savoir que j'étais recalé quant à une abilitation à œuvrer sur des projets classés "Secret Défense" Dont acte. Suite à quoi, le jour même, ou peu après, mon patron, Monsieur Martin (C'était son nom) m'apelle à son bureau. sur ce dernier, le téléphone avec le combiné décroché. Il m'invite à le prendre. Á peine me suis-je présenté que mon interlocuteur me demande:
Votre père a-t-il fait partie de l'OAS ?J e ne me souviens pas avoir été surpris par une telle question. Pourquoi ? Peut-être avais-je épuisé mon stock d'étonnement. Mon interlocuteur prend acte de ma réponse, termine rapidement l'entretien, et raccroche. Quelques jours plus tard, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une étrange malaise. Á l'époque je l'occupais un studio avenue du Roule à Neuilly sur Seine. Un étrange malaise, parce que en entrant, j'ai eu cette bizarre impression que le lieu a été visité en mon absence. Bien sûr, il n'y a pas eu effraction, les objets semblent restés tels que je les avais laissé en partant. Néanmoins, j'éprouve une sorte de malaise. J'ouvre les tiroirs d'un bureau, rien n'a disparu. Mais je ne peux dire que rien n'a bougé.
C
et évennement s'est déroulé aux début des années 1980. Au bureau, les
travaux touchant à la défense nationale m'ont été retirés. C'était l'époque de la guerre froide. Paranoïa de ma part ? peut-être. Il me faut préciser
qu'à la même époque, je fréquentais une personne plus agée que moi. Une
cougar dirait-on aujourd'hui. Cette personne avait
fréquenté un ancien pilote de l'escadrille
Normandie-Niemen. Ce gars se suicide en août 1969 alors que la DST vient l'arrêter pour appartenance
à un réseau d'espionnage roumain.

C e que je ne pouvais ignorer. Á la même époque, cette dame militait pour des mouvements type "France-URSS" Organisation très mal vue des autorités Françaises. En pleine guerre froide, pareil soupçon pouvait générer quelques problèmes. Pour preuve, dans la Marine, le fait d'avoir un(e) aïeul avec des origines des pays de l'Est valait un refut définitif pour embarquer à bord des SNLE c'est dire.
Q
uelques années plud tard, deux événements anodins au premier abord viendront me rappeler cet épisode.
Ironie de l'histoire, peut-être, des années plus tard je vivrai une décennie dans la
ville natale de l'un d'eux.
 Je reste à mon poste à peu près deux ans et démissionne à la grande
surprise de mon patron. J’étais fou m’a-t-il dit. Je pense qu'il était
sincère.
Ma rémunération augmentait tous les trimestres. Résultat des courses,
mon salaire a doublé en deux ans. Mais était-ce suffisant pour que je
reste à son service ?
Je me souviens d'un jour, ou d'un soir, où la charge de travail devait
être importante, il me propose de me ramener chez moi. Suresne/Neuilly,
en porche, ça a été rapide.
Je reste à mon poste à peu près deux ans et démissionne à la grande
surprise de mon patron. J’étais fou m’a-t-il dit. Je pense qu'il était
sincère.
Ma rémunération augmentait tous les trimestres. Résultat des courses,
mon salaire a doublé en deux ans. Mais était-ce suffisant pour que je
reste à son service ?
Je me souviens d'un jour, ou d'un soir, où la charge de travail devait
être importante, il me propose de me ramener chez moi. Suresne/Neuilly,
en porche, ça a été rapide.
J' ai œuvré ensuite dans quelques petits bureaux d’études, et en parallèle des cours de préparation au CNAM pour, au moins valider un niveau de terminale. A ce propos, je me souviens de cette anecdote.
Ces cours du soir imposaient des devoirs à faire le soir. Là, pour le coup, je ne me suis pas défilé. Ces devoirs consistaient à résoudre moult équations. Et un soir lors du cours, le professeur demande aux gens de venir au tableau exposer leur travail du soir. Pour ma part, je n’ai quasiment rien fait. Je n’ai rien compris.
Néanmoins, je lève le doigt pour résoudre un exercice. Sur l’estrade, j’exécute, développe les calculs et affiche un résultat. Le professeur regarde, demande à l’assistance s’il y a des objections. Pas de réaction. C’est bien. Je peux retourner à ma place. Arrivé à ma place, je scrute le tableau et ne comprends rien à ce que j’ai écrit. Aussi avant que le professeur n’efface pour laisser la place au suivant, je m’empresse de laborieusement recopier ce que j’avais brillamment développé peu avant.E ntre-temps, influencé par la personne avec qui j’étais en liaison (pas lésion) j’embraye avec un « Institut de Recherches Psychanalytiques » près de Chartres. Vu mon état psychique, je ne pouvais faire autrement. Cet organisme s'est révélé être une tartufferie de première façon secte. Aussi, n'y suis-je pas resté longtemps.
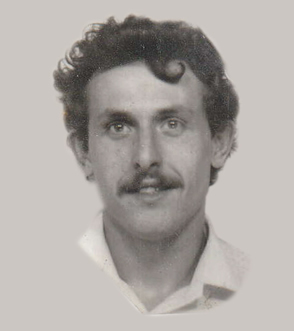
E
n juin, j’obtiens le sésame pour le CNAM. Mais je ne poursuis pas.
Grâce à une connaissance, j'ai intégré une société qui œuvrait dans le
charbon. J’ai donc encore dessiné, mais des usines.
C"est à cette époque où, pour pouvoir voler, j'ai fait en sorte de pouvoir bénéficier d'une greffe
de cornée et d'un implant de cristalin artificiel.
Et, à la clef un trimestre pour récupérer.
Á peine revenu au bureau, il m'a été demandé si j'étais partant pour descendre au Maroc diriger
une équipe de nuit et procéder à une modernisation
d’une usine. Et ce, en plein hiver dans la neige.
Le temps de procéder d'urgence à l'élaboration de mon passeport
, La semaine suivante, j'étais dans l'avion.
La mine et l'usine attenante se trouvaient sur un site dénommé
Jérada situé à quelques kilomètres de Oujda une petite ville près de la frontière Algérienne.
Cette usine de construction métallique sur quatre étages était un peu
délabrée. Mon rôle consistait donc à faire receptionner les équipements
et machines venus de France. Et les faire installer. D'emblée, je suis
projeté dans le cadre de la condition ouvrière début XXème siècle. Zola
n'aurait pas été dépaysé. Cette équipe était constituée d'une vingtaine
de personnes dont le contremaître chargé de transmettre mes directives.
Ce contremaître n'était pas tendre avec ses gars. Parmis eux, se
trouvaient un petit monsieur voûté, chenu qui trottinait aussi vite
qu'il pouvait pour obtempérer aux ordres brutaux du contremaître. Et un
gamin qui ne devait guère avoir plus de douze ou treize ans. Qui comme
les autres portait de lourdes charges.
P assé quelques nuits, j'ai ordonné au contremaître de mettre le petit vieux au magasin pour distribuer les boulons et autres éléments utiles à l'ouvrage. Quant au gamin, il fera coursier pour porter les dits boulons aux autres compagnons. Le contremaître a râlé. Me faisant savoir que l'on allait perdre du temps. J'ai réitéré mon ordre. Il s'est exécuté en bougonnant. Pour ma part, je me sentais soulagé. Il y a eu aussi cet ouvrier blessé à la tête par une poutre, qui, dixit mon contremaître n'avait pas droit à l'infirmerie, car c'était un intérimaire. Là, je me suis fâché. Et le gars est allé se faire soigner à l'infirmerie.
C'
est à cette époque que j'ai demandé à intégrer la reserve marine.
Peut-être un peu de nostalgie, peut-être pour m'évader un peu.
Mon père avec qui je reprends contact allait ou revenait d'une période à bord du
Casabianca. Navire à bord duquel j'ai navigué pendant une année après le Vauquelin.
 Toujours est-il que j'ai été poliment
Toujours est-il que j'ai été poliment
 éconduit. Je n'ai pas eu le temps de m'en offusquer, le tourbillon de la vie
(comme le chantait Jeanne Moreau) me poussait toujours en avant. Et tel
le bouchon de liège à la surface de l'océan, je monte, je descends au
gré des vagues et dérive vers je ne sais où, au gré des courants.
éconduit. Je n'ai pas eu le temps de m'en offusquer, le tourbillon de la vie
(comme le chantait Jeanne Moreau) me poussait toujours en avant. Et tel
le bouchon de liège à la surface de l'océan, je monte, je descends au
gré des vagues et dérive vers je ne sais où, au gré des courants.
 A
près ce fut l’automobile avec les débuts de la
CAO
A
près ce fut l’automobile avec les débuts de la
CAO
 (conception informatique), la simulation (Calcul de structures)
J'ai bien aimé.
bien que les ordinateurs de l'époque étaient longs au calcul. Cet
épisode a pris fin le jour où un type qui ignorait ce qu'est un
ordinateur a été désigné pour me "piloter". Il me fait faire une
connerie, moi, perplexe,
j'obtempère. Résultat des courses, je me fais sacquer. Le connard n'a
pas assumé, et j'ai payé. Connaissant son profil, un peu de méfiance de
ma part à son égard m'eût évité
ce fâcheux évènnement. Comme quoi, dans certains cas, il est vital de
détruire les médiocres quand ceux-cis sont nommés à un poste trop pointu
pour eux.
P
uis l’aéronautique et le spatial. Ces derniers domaines me
semblaient un peu en retard quant à la conception CAO.
Les
courbes de Bézier
leur étaient inconnues (Un comble pour des entités qui se voulaient à la pointe de la technologie)
Dans l’aéronautique me laisser imposer de réaliser les plans en 2D avant la 3D ! m'a fait déboiter !
Ëtre cornaqué par des tocards me devenait insuportable.
aussi je choisis de retourner à l’automobile. Dans l’ingénierie.
(conception informatique), la simulation (Calcul de structures)
J'ai bien aimé.
bien que les ordinateurs de l'époque étaient longs au calcul. Cet
épisode a pris fin le jour où un type qui ignorait ce qu'est un
ordinateur a été désigné pour me "piloter". Il me fait faire une
connerie, moi, perplexe,
j'obtempère. Résultat des courses, je me fais sacquer. Le connard n'a
pas assumé, et j'ai payé. Connaissant son profil, un peu de méfiance de
ma part à son égard m'eût évité
ce fâcheux évènnement. Comme quoi, dans certains cas, il est vital de
détruire les médiocres quand ceux-cis sont nommés à un poste trop pointu
pour eux.
P
uis l’aéronautique et le spatial. Ces derniers domaines me
semblaient un peu en retard quant à la conception CAO.
Les
courbes de Bézier
leur étaient inconnues (Un comble pour des entités qui se voulaient à la pointe de la technologie)
Dans l’aéronautique me laisser imposer de réaliser les plans en 2D avant la 3D ! m'a fait déboiter !
Ëtre cornaqué par des tocards me devenait insuportable.
aussi je choisis de retourner à l’automobile. Dans l’ingénierie.

D ans mon existence, j'ai eu des sentiments amoureux, mais fugaces. Le râteau et 24 heures plus tard, j'étais guéri. Sauf une fois il y a plus de 30 ans, je croisais la route d'une jeune femme un soir dans un pub place de la République (à Paris) Je sortais d'une relation boiteuse (pour ne dire plus) Accoudé au comptoir, cette jeune femme trouve une place près de moi, se commande un verre. Avant même qu'elle ne prenne place, je l'ai observée à la dérobée. Et me suis dit: "Elle est trop belle pour toi, oublie..." et de repiquer mon nez dans ma pinte de bière.
L a première piqûre arrive lorsqu’elle me demande du feu. En ces temps-là, le tabac avait droit de citer everywhere. Je parle de piqûre parce que j'ai commencé à m'injecter une drogue dure, très dure. J'ai donc plongé et commencé à échanger avec elle. Je n'ai pas le souvenir quant aux propos échangés sinon que de sa part, elle quittait un mec violent. D'où son désarroi. Nous avons bu, discuté, beaucoup bu, beaucoup discuté. Et in fine l’ai amené chez moi. L’alcool n’a pas aidé. Le matin il n’a pas fallu trainer, elle avait un train à Montparnasse pour rentrer chez ses parents. Je l’y ai donc mené en promettant de se recontacter à son retour à Paris.
Cette année là, est sorti un film et il me semble que nous avions assisté à une première au cinéma Le GrandRex.

L
a musique de ce
film m'est durablement incrustée dans ces événements. Résultat, à l'issue de cette histoire,
cette musique me sera insuportable à entendre pendant plus de vingt ans.
 À moins que ce ne fût
celui-ci
À moins que ce ne fût
celui-ci
 La chronologie m'échappe. Le contexte y est sans doute pour beaucoup.
La chronologie m'échappe. Le contexte y est sans doute pour beaucoup.
C e n'est pas simple d'être compliqué...
E n rentrant chez moi, les effets du manque ont commencé à se manifester. La fin du Week-End sera pénible. Les journées suivantes au bureau n’étaient pas mieux. J’ai attendu quelques jours souhaitant que ce fût elle qui appelle en premier. Ce ne sera pas le cas, aussi n’y pouvant plus, je prends l’initiative et lui propose un plan restaurant. Ce que gentiment elle accepte. Le soir ou lendemain soir je la revois. Injection massive dans les deux bras, la tête, le cœur… Je ne lui ai parlé d’amour qu’une seule fois. Elle de me répondre qu’elle a déjà donné…
D urant presqu’un an, je l’ai revue chaque semaine. Au fur et à mesure, elle a eu des gestes tendres, c’est du moins ainsi que je les ai perçus. Mais à chaque fois, je me suis dérobé de peur de la voir s’éloigner. Comme la fois où lors d’un diner au restau, elle a semblé vouloir toucher ma main. Que j’ai retirée … La fois où attendant le métro pour la ramener chez elle passe une main sur mon épaule pour toucher dit-elle le col du blouson en mouton que je venais d’acheter. Et moi de me reculer. La quitter sur le pas de sa porte relançant le manque qui allait me tarauder jusqu’à la fois suivante.
J' aim'rais qu'elle fasse le premier pas Je sais que cela ne se fait pas. Pourtant j’aimerai Que ce soit elle qui vienne à moi Car, voyez vous, je n’ose pas...
L' été, je lai amenée dans une maison que j’avais dans le Var. Nous sommes descendus en voiture. Pendant tout ce temps, je n’ai osé ni voulu tenter quoi que ce soi tant je craignais de briser quelque chose. Comme porter des deux mains un vase de cristal ultra fin et de ne pouvoir en libérer une pour me gratter la tête. Au retour à Paris, cela a duré encore quelques semaines. Aussi n’en pouvant plus, la journée au bureau, je n’avais qu’elle en tête. Et la nuit de même, le sommeil en moins. Un soir donc, après l’avoir ramené chez elle, et sitôt rentré chez moi, je prends le téléphone, l’appelle pour lui dire que je ne la reverrai pas. Je me souviens (ou crois me souvenir) que lorsqu’elle a décroché et m’entendant, le ton de sa voix semblait sinon enjoué, du moins avec de l’allant. Un ton qui m’a semblé s’éteindre quand je lui fais part de ma décision. Mais ne fait aucune remarque. Sinon de me demander si c’est définitif. Je le lui confirme. Elle en prend donc acte. Ce devait être un vendredi soir. J’ai passé le reste de la soirée et une partie de la nuit pour lui écrire une longue, très longue lettre lui expliquant les raisons de mon choix. Et le matin de très bonne heure, je me suis rendu chez elle déposer la missive dans sa boite aux lettre. J’habitais rue de Bagnolet, elle vers la porte de Montreuil, je crois…
L es jours et les quelques semaines qui ont suivi ont été une lutte pied à pied contre moi-même pour ne pas la rappeler. C’était pire qu’avant. Le manque était épouvantable. Je me disais que le sevrage ne devrait pas tarder. Il a tardé, et un soir n’y tenant plus, je décroche mon téléphone pour lui demander de ne pas tenir compte de ce que je lui avais dit et de l’inviter à diner quelque part. Ce qu’elle accepte. Et là, je replonge. Encore quelques temps. L’automne arrivant, j’ai l’occasion par le biais du copain de ma sœur de descendre des vieilles 504 Peugeot en Afrique. Lors d’une soirée, je dis à Anne-Marie (Car tel est son prénom) que je serai absent pendant trois semaines. Elle me demande si j’acceptais de l’emmener avec moi. Je ne me souviens pas de ma réponse. Néanmoins, ma sœur qui était au courant de mes errements sentimentaux me dissuade d’accepter. Le plan copain-copine ne tient pas la route.
E t c’est le cœur chaviré que je démarre la voiture à Blois. Direction Niamey. Et ce ne seront pas les soirées alcoolisées à Sidi Bel Abbes, les en-sablages sur la route de Tamanrasset, les soirées « pétards » avec les douaniers du cru qui changeront quoi que ce soit.
A rrivés sans encombre à Oujda. C’est drôle, la destinée de systématiquement me ramener dans des lieux déjà fréquentés. Ce sera également vrai pour Ghardaïa. Où en 1960, ou à peu près dans la piscine d’un hôtel de l’époque, que je n’ai pu retrouver j’ai bu ma première tasse. Donc arrivés sans encombre à Oujda, l'organisateur de la balade me demande de reprendre une voiture qui n’a pas de papiers en règle. Charge pour moi de me démerder pour lui faire passer la frontière. D’autant que celle-ci est bourrée des pièces automobile à refourguer en Algérie. Á l’époque formellement interdit. La monnaie Algérienne avait des problèmes. Je prends donc la voiture ainsi qu’une liasse de papiers officiels vierges relatifs à la vente de véhicules en France.
C
harge pour moi d’en faire bon usage pour passer la frontière.
La journée se termine, les autres voitures sont déjà en Algérie sur la route de Sidi Bel Abbes.
Je gare la voiture à proximité du poste frontière de
Zouj Beghal et me met à l’ouvrage pour confectionner un document apte à rendre le véhicule légal aux
yeux des douaniers.
 Je prends un exemplaire et consciencieusement de le remplir avec
le maximum de soin.
Dans le « maximum de soin » j’entends le maximum de cohérence sinon de réalisme.
Dans la rubrique « Vendeur », je mets un nom et un prénom imaginaire mais
néanmoins plausible. De même pour l’adresse. L’acheteur, moi en l’occurrence,
donc pas d’embrouilles. Ce sera la seule partie du document qui sera vraie.
Je vais même jusqu’à renseigner le numéro de mon passeport.
Pour la validation supposée des autorités compétentes quant à l’officialisation de la
vente de la voiture, un peu d’imagination sera nécessaire.
Pour faire le tampon officiel de la préfecture, la gravure de Marianne sur une pièce de
vingt centimes tartinée de ce qu’il faut d’encre de mon stylo à billes
apposé en bas de la feuille avec un gribouillis sensé être la signature du préfet de la
région où la voiture est sensée avoir été
acquise.
Je prends un exemplaire et consciencieusement de le remplir avec
le maximum de soin.
Dans le « maximum de soin » j’entends le maximum de cohérence sinon de réalisme.
Dans la rubrique « Vendeur », je mets un nom et un prénom imaginaire mais
néanmoins plausible. De même pour l’adresse. L’acheteur, moi en l’occurrence,
donc pas d’embrouilles. Ce sera la seule partie du document qui sera vraie.
Je vais même jusqu’à renseigner le numéro de mon passeport.
Pour la validation supposée des autorités compétentes quant à l’officialisation de la
vente de la voiture, un peu d’imagination sera nécessaire.
Pour faire le tampon officiel de la préfecture, la gravure de Marianne sur une pièce de
vingt centimes tartinée de ce qu’il faut d’encre de mon stylo à billes
apposé en bas de la feuille avec un gribouillis sensé être la signature du préfet de la
région où la voiture est sensée avoir été
acquise.

S atisfait de mon œuvre, je m’engage dans la file d’attente. Le jour commence à tomber quand mon tour arrive de présenter les papiers du véhicule. Dans un baraquement en bois, séparé dans la longueur par un long desk avec derrière les employés de l’administration. Je me présente à l’un d’eux. Nous discutons un peu. Il me fait savoir qu’il n’est pas douanier mais étudiant et se fait un peu d’argent en soulageant la tâche des fonctionnaires. Je le félicite. Initiative qui crée un semblant de complicité bienvenu. Bienvenu, parce qu’en parcourant mon document, il lève les yeux vers moi, me rend la feuille et me dit à voix basse :
B on. Je le remercie, reprends la voiture et retourne dans le parking attenant du poste frontière. J’inspecte mon document pour peut-être y déceler une criante erreur à corriger. Je ne trouve rien et ne vois rien à y faire. Aussi, comme il me faut absolument passer, je choisis de repasser le lendemain à la première heure. Où je pourrais espérer trouver des fonctionnaires pas trop réveillés ni trop zélés pour valider mon document. Je suis donc contraint de passer la nuit sur ce parking et être opérationnel dès la réouverture des bureaux. Je n’ai pas souvenir de cette nuit. Toujours est-il qu’au lever de la barrière, j’ai de nouveau engagé ma voiture devant ce bureau. Je suis dans les premiers. Là, plus d’étudiant mais des fonctionnaires en uniforme. Mon tour arrivant, je présente de nouveau mon papier. Le fonctionnaire le parcourt d’un œil blasé, le tamponne, me le rend et m’indique le bâtiment où se trouve le guichet pour la suite du cheminement administratif. Le plus pénible est passé. le reste n’est que pure formalité.
D ans ce second bureau, après représentation de mon passeport prend un papier et se rend avec moi à la voiture pour consigner tout ce qui, dans la voiture est susceptible d’être négocié sur le territoire algérien. En cela, le moteur calé dans le coffre, les pneus d’occasion sur la banquette arrière et diverses pièces détachées. Ce faisant, arrivé sur place, il n’a pas de quoi écrire. Moi, prévenant, lui tends un stylo. Il semble me savoir gré de n’être pas forcé de retourner à son guichet pour remplir sa mission. Je ne sais plus si ça a été intentionnel de ma part, mais par un heureux hasard, je lui ai passé un stylo effaçable. Ce qui par la suite me sera bien utile. En effet, pour moult raisons, j'ai été amené à négocier des éléments dûment répertoriés sur le document officiel. Donc officiellement invendables. Aussi, après chaque vente, j'efface le contenu de la ligne correspondante et réécris ce que je serai censé ne pas avoir vendu à la sortie du pays. Á savoir, ma montre, une paire de chaussures et autres objets anodins. Le passage au poste frontière de In Guezzam, après Tamanrasset pourra ainsi se faire sans problèmes.
O
ù j'ai rencontré Aïcha (Ce n'est pas son vrai prénom, je l'ai oublié) à Sidi Bel Abbès.
Une nana divorcée. Ce qui sous ces lattitudes n'était pas vraiment bien considéré.
Elle voulait changer d'air. Nous avons fait connaissance, m’a invité chez elle.
Fait un peu plus connaissance…
Voulant en savoir plus sur moi, je lui dit que je descend une voiture au Niger.
Elle me fait part de son interrêt quant à la balade. Ce que j'accepte sans trop me faire prier.
Cela mettra un peu de piment au trajet. Et jusqu'à Ghardaïa, je ne dirais pas que c'est la fête, ce
serait beaucoup dire, mais même sans alcool, l'ambiance est détendue.
Sur la route, je me contente de suivre la voiture qui me précède. Arrivés à Ghardaïa en début de soirée,
la première préocupation consistera à trouver un hôtel. Ce qui sera fait sans trop de difficulté. Les tours opérateurs ne
semblent pas avoir encore jeté leur dévolu dans la région. Ce ne sera pas plus mal, en effet, l’hôtel choisi a l’apparence d’un
établissement distingué.
 À ceci près que la salle du restaurant, rien n'est en place. Derrière le bar
quelques canettes de soda posées à droite, à gauche. C'est tout. Nous somme allés nous restaurer
dans une gargotte à proximité.
La piscine valait aussi le détour. En arrivant au bord, l'eau au lieu d'être comme il se devrait limide
a un aspect laiteux. Et une fois dans ce qui devrait être de l'eau, de longs filament blancs évoluaient paresseusement dans le liquide. et au fond, c'était glissant. Nous ne nous sommes pas attardés.
À ceci près que la salle du restaurant, rien n'est en place. Derrière le bar
quelques canettes de soda posées à droite, à gauche. C'est tout. Nous somme allés nous restaurer
dans une gargotte à proximité.
La piscine valait aussi le détour. En arrivant au bord, l'eau au lieu d'être comme il se devrait limide
a un aspect laiteux. Et une fois dans ce qui devrait être de l'eau, de longs filament blancs évoluaient paresseusement dans le liquide. et au fond, c'était glissant. Nous ne nous sommes pas attardés.
E n sortant de Ghardaïa, embranchement vers Ouargla et Hassi-Messaoud vingt-huit ans au plus tôt, mais ce n’est plus d’actualité. Cette fois-ci, direction El Golea. Sur une intersection venant de nulle part et allant guère ailleurs, deux Rover de la gendarmerie attendent. M’attendent, sans doute, me font signe de m’arrêter. Je m’arrête. De quoi suis-je coupable ? Á la gauche de la voiture, un policier me demande mon passeport. Je m’exécute. Á la droite de la voiture un autre policier demande le passeport de Farida. Elle s’exécute. Le policier consulte son passeport. Farida est de nationalité Algérienne ! Que fout-elle donc avec un Français ? Là, les choses commencent à se compliquer. Benoîtement j’argumente que j’ai proposé à Farida de lui montrer Tamanrasset. Mon argument, visiblement ne porte pas. Un des policiers ordonne à Farida de rejoindre le 4x4 gendarmesque. Et un de ses collègues de m’ordonner de reprendre ma route. Ces aimables fonctionnaires vont attendre le prochain bus à destination de Sidi-Bel-Abbès pour y mettre Farida. Une ligne de bus Ghardaïa-Sidi-Bel-Abbès, je n’y crois guère. D’autant que ce croisement situé au milieu de nulle part ne semble pas propice aux arrêts de bus. En pareille circonstance, le doute, voire la méfiance à l’égard des policiers s’installe en moi. Aussi je choisis de rester jusqu’à l’arrivée du bus et leur fait donc savoir. Décision qui semble avoir un peu agacé l’un de mes interlocuteurs. Et sans doute pour me le signifier, sort son arme de service, engage une balle dans le canon et me la colle sur le ventre. Je ne réagis pas. Je ne me souviens pas du temps passé. Reste que au bout d’un moment, le fonctionnaire dégage son arme, la neutralise et la remet dans son étuis.
M' explique l’aimable fonctionnaire. J’en suis ravi. Mon existence ne se finira pas malencontreusement sur ce carrefour perdu. Ils retournent vers leur 4x4 et s’y installent. Je fais de même dans ma 504. Deux, trois, voire quatre heures se sont écoulées. Le soleil est à son zénith. Il commence à faire très chaud. Dans le rétroviseur, je vois Farida quitter le véhicule policier et venir vers le mien.

J
e ne suis pas sûr de les avoir convaincus, mais mes propos enflammés semblent leur convenir.
Á défaut de pouvoir me dessouder tranquillement pour se farcir la fille, ils doivent
considérer que leur journée de service se termine et que
le jeu n’en vaut pas la chandelle, autorisent Farida à me rejoindre et moi de me tirer
au plus vite.
Ce que je ne manque pas de faire. Et en route vers Ain Salah. Inutile de préciser que
l’ambiance s’est considérablement dégradée.
Les six cent kilomètres qui nous séparaient de l’étape suivante n’ont pas été, malgré
la température extérieure, des plus torrides.
El Golea, à mi-chemin n’aura été qu’une furtive étape.
Arrivés à Ain Salah, le soir commence à tomber. Le premier hôtel sera le bienvenu.
Prendre une chambre sans présenter un certificat de mariage est compliqué. Le patron de
l’établissement est conciliant et nous en attribue une. Enfin, pas tout à fait. Ce sont
deux chambres contiguës avec une porte pour passer de l’une à l’autre. Sympathique attention,
mais lourd de de sous-entendus. Á défaut d’autre, je prends.
Après un repas dans un petit restaurant local, le retour à l’hôtel n’est pas nimbé d’une
sensualité torride. Farida flippe à mort.
Résultat: chacun dans sa chambre. Il n’en reste pas moins que passé minuit, une heure du matin, des coups frappent à la porte
de ma chambre.
L' ordre n’appelle aucune réserve. Á peine le temps de m’habiller, je suis dehors et les suis. Je passe le reste de la nuit au poste de police en cellule. Non pas de dégrisement, je n’ai pas eu l’occasion de boire quoi que ce soit. Mais une forme de dégrisement quand même. Au matin, je suis libéré et de récupérer Aïcha et de reprendre la route vers Tamanrasset. 660 Km à se farcir ! Mais qu’importe ! Je ne me souviens plus des heures passées pour y arriver. Le trafic n’était pas au maximum. Á Tamanrasset, direction l’aéroport. Trouver le premier vol pour Alger. Cette fois-ci, ça n’a pas été compliqué. Je vais faire l’emplette du billet, le donner à Aïcha. Rapides adieux. L’avion décolle peu de temps après. Il faut dire, qu’à l’époque, Tamanrasset n’était pas encore classé comme aéroport international.
P
assé cet intermède, je rejoins les collègues déjà arrivés depuis peu.
Je gare ma voiture près des trois autres soigneusement serrées cote à cote. Le soleil commence à disparaitre, la nuit tombe.
Pour la suite, je n’ai pas souvenir des circonstances qui nous ont amené au poste de police. Non pas pour y régler un contentieux
avec les autorités mais pour y boire ou du thé ou de la bière, ma mémoire me fait défaut. Néanmoins, la soirée avance un policier
nous propose une cigarette. Pour ma part, j’accepte. Avant même que le fonctionnaire me l’allume, force est de constater que cette cigarette
a un parfum particulier. Pas désagréable. Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste pour constater que le tabac ne rentre pas entièrement
dans la composition de l’objet. Je ne ferai pas l’apologie des herbes autre que le tabac, aussi je ne m’étendrai pas sur la suite.
Parce que je ne m’en souviens plus.
Je ne me souviens également plus où nous avons dormi cette nuit là.
À cette époque, ce rustique abri servait principalement de ce qu'il est convenu d'appeler un gîte d'étape. Et de fait, pouvoir y dormir.
Au matin de très bonne heure, le soleil commence à se lever. Un couple de Japonais qui partageait avec nous
l'abris étaient déjà dehors l'appareil photo collé à l'oeil, figés, manifestement sous le charme du
panorama

Un point de vue à 2700 mètres d'altitude, sans neige, sans remontées mécanique et sans skieurs. Il va sans dire que pour y monter, les pneus neige n'étaient pas indispensables. Le retour, ou plutôt le redescente est plus rapide. Est-ce dû à la dextérité acquise par notre chauffeur ou bien la simple gravité ?
Peut-être avait-elle déménagé ? Je suis à la fois soulagé et déchiré.
Soulagé, parce que je ne pourrai plus me droguer.
Et déchiré pour la même raison.

D e longues et pénibles semaines ont suivi. Plusieurs mois aussi. Ne plus avoir la perspective de la voir était chaque jour un cauchemar. Un cauchemar qui ne finissait pas. Cela a duré presque un an encore. Jusqu’au jour où j’ai contacté le lieu où elle travaillait à l’époque. J’ai eu une de ses anciennes collègues qui m’a bien aimablement donné ses nouvelles coordonnées. Et un après-midi au bureau, je l’ai de nouveau rappelée. Elle a semblé enchantée de m’entendre. Et m’annonce son mariage et dans la foulée m’invite à ce dernier… Pour ce faire, me donne son nouveau numéro pour convenir des modalités quant à la tenue de la cérémonie. Je m’empresse de ne rien noter, et essaie de ne rien retenir…
I l y a un an presque jour pour jour, j'ai arrêté d'écrire. Une parenthèse de 365 jours ! C'est le temps, je pense qu'il m'a fallu pour remonter la pente. Je n'écris plus pour me noyer, m'immerger dans ma détresse, ce n'est plus de mise. Je redémarre, je veux redémarrer, je veux effacer ces deux années d'enfer. Je veux ces lignes empreintes non pas d'ironie qui masquerait une certaine aigreur, mais de légèreté et surtout de sérénité. Ce livre sera le cliché de mon vécu intérieur. Pas forcément au jour le jour mais au gré de l'inspiration du moment. Je ne veux plus que la détresse ait prise sur moi. Je veux être lisse, inaccessible à ces sentiments dévastateurs J'ai tout à gagner à me conforter ainsi. Il est vrai que parfois, la sérénité me glisse des doigts. Aussi, je me fais un devoir de la rattraper au vol. Je ne l'ai pas encore apprivoisée. Il me faut la dompter seul. Après quoi, je me sentirai vraiment libre, et ma reconstruction achevée. Pour l'instant, les pierres sont en place et le ciment encore frais et ne peut, pour l'instant remplir son rôle. Aussi, prudence, pas de mouvements brusques ni d'emportements inconsidérés.
I l est midi et des poussières. Quelques réflexions sur des pensées qui reviendraient insidieusement J'en suis encore à me dire, à propos d'A.M. que j'aurais dû faire ou dire. Ou être ceci plutôt que cela. Je me trouve parfois bien con. Mais chose positive, quand j'en appelle à la raison, je me dis que ce que j'ai fait ou été correspondait à un moment où je devais vivre certaines choses qui m'ont permis d'avancer. Tout cela aura été un grand coup de pied au cul. Cette vision des choses me rassure un peu. Il n'en reste pas moins que j'éprouve un vide immense que pour l'instant, ne peux combler. Je vis une grande période de flottement. De flottement dans tous les domaines. J'ose espérer y voir une période de gestation. Il y a tellement de remises en cause en ce moment Qu'est-ce que je veux, qui suis-je ? J'ai du mal à me cerner. Mais en aucun cas, je ne chercherai à me d érober à ces interrogations par des artifices qui ne seront, je le sais, que des emplâtres qui, non seulement ne résoudront rien mais me feraient reculer. Est-ce encore de l'immaturité que, encore d'avoir mal quand les pensée pour AM me reviennent ? Que sais-je. C'est pénible. Il est possible que mon masochisme latent y trouve son compte. Ce doit être tellement bon d'avoir mal ... Néanmoins, je ne suis pas convaincu de la solidité de mon assertion. Mais qu'est ce qui est vrai chez moi ? Même professionnellement, il y a flottement, je n'arrive pas à m'impliquer dans ce que je fais. Il me faudra changer, bien sûr ! Mais pour quoi ? J'espère quand même partir à Toulouse. J'espère aussi, un jour être heureux.
J' ai passé le WE au Moulin avec Claude. J'y ai vécu de gros flottements. Largement imbibés de blues... AM bordel de merde ! vivement que je me la sorte de la tête. Enfin, ça viendra, il faut être patient. Demain, j'aurai 34 ans, l'heure de la grande résurrection va sonner. Plus de deux années d'enfer devant être passées. Le moment où je vais enfin me trouver ne devrait pas tarder.
J Je ne sais trop quoi penser, ce n'est pas grave, les idées viendront en temps et en heure.
V oilà deux jours que je suis rentré à Paris. J'ai eu l'occasion de faire bien des choses dans l'Hérault, ça m'a plu. Me voilà donc de retour. La solitude me pèse, mais ne ferai rien contre à n'importe quel prix. Je me dois de laisser faire les choses. Le mois d'août passera vite, je le pense. Et le souhaite aussi ...
À Saint Martin, j'ai lu un bouquin sur la pensée bouddhiste. Ça me plaît bien, mais je n'arrive pas à l'appliquer. Ou pas encore. A savoir vivre au présent. C'est vraiment tout con, mais je suis cr gratiné» et j'ai un mal fou à mettre tout cela en pratique. Allons, allons ! un peu de patience, cela viendra en temps et en heure....Q uelques temps plus tard, je me suis mis en ménage avec une personne qui avait deux très jeunes garçons. Cela me donnera une raison de m’investir. Sur les quinze ans qu’a duré cette liaison, les trois, voire quatre premières années ont été difficile, je n’étais pas encore sevré. Puis un jour, tout s’est éteint. J’étais libéré. Je me suis laissé tenter à construire quelque chose de pérenne. Non sans mal. il m'était impossible de me projeter à long terme. Alors faire l'acquisition d'une maison ... Ce qu'à contre cœur, à la demande de la compagne du moment je m'y suis résigné.

L orsque mon ménage a explosé, je n’ai pas ressenti grand-chose sinon que suis parti en vrille avec une gonzesse qui m’a pillé tout l’argent que j’avais de la vente de la maison que l’on avait acheté . Depuis, je suis guéri. Je n’éprouve rien, ne suis en manque de rien. C’est beaucoup plus confortable. Et avec du recul, me demande si ce n’était pas un peu puéril. Peut-être Ce que à l'époque je pensais "pusillanimité" était en fait, peut-être mieux que cela ?


A u cours d’une de mes missions j’ai eu à côtoyer le design. Des éléments de mon périmètre y étaient impactés. J’avais constaté un énorme fossé conceptuel entre le design et l’ingénierie. Au bout d’un moment, j’ai commencé à m’ennuyer dans mes fonction successives. J’ai donc passé un bilan de compétences où il est apparu que compte tenu de mes capacités créatives (dixit les tests), le design m’irait très bien. Cela me permettra de connaître les schémas intellectuels des designers qui choquent tant les ingénieurs. Il m’a fallu chercher la bonne école capable d’être financée par le FONGECIF. L’école de design de Chicago n’étant pas la bonne idée, j’ai déposé un dossier de candidature pour l’ Université de Compiègne
J e suis convoqué pour un entretien. Je n’ai jamais eu droit à un entretien aussi « saignant » Cela a été très dur. En effet, cette école ne recrute que des gens brillants, m’a-t-on dit. Sans doute pour évaluer ma motivation. Toujours est-il qu’en rentrant chez moi, j’étais convaincu d’être recalé. Mais quinze jours après j’ai été appelé pour me donner la date de début des cours. J’étais donc accepté. Entre temps, j’ai eu un accident de voiture. Aussi, je suis entré à l’université en septembre avec deux côtes cassées.
D ans ma promo, il y avait un couple d’étudiants chinois venus de l’université de Pékin, un ingénieur Japonais de l’université de Tokyo et un Espagnol de l’université de Madrid. Et aussi un gars qui a laissé tomber l’X (polytechnique) pour le design. Les horaires officiels de travail étaient de huit heures à dix-sept heures. En fait c’était plutôt six heures à minuit quand ce n’était pas plus. Une anecdote. La nuit qui a précédé une soutenance, l’étudiant Japonais a passé la nuit dans la salle des ordinateurs pour préparer son travail. On l’a trouvé endormi à côté d’un radiateur. Il avait terminé son mémoire. Jusqu’en mars, avant le stage, ça a été la course de fond, le nez dans le guidon, comme il est d’usage de dire.
J' ai appris que j’étais reçu en septembre. Il m'a néanmoins fallu du temps pour admettre que ce parchemin ne m'avait pas été donné uniquement par compassion. Nous sommes retournés à l’UTC pour officialiser. C’est à ce moment que j’ai appris qu’un an avant, il y a eu plus de trois cent cinquante postulants pour quinze places.

D e retour dans ma boite, je n’ai pas eu ce que l’on m’avait laissé espérer. J’ai donc démissionné. Et depuis, je fais de l’intérim sur des missions diverses pour lesquelles je n’ai aucune formation, mais parfois bien rémunérées. Quant au design, à l’âge où j’ai décroché mon parchemin, pour démarrer dans le design, il m’eut fallu avoir un book épais comme un dico. Il n'en reste pas moins que l'objet de ma soutenance (2004) se trouve sur toutes les voitures récentes.

I l y a 30 ans, j'avais imaginé ceci. Un système de stationnement automatique. C'est une copie du document Word de l'époque. Le 18 Avril 1994.
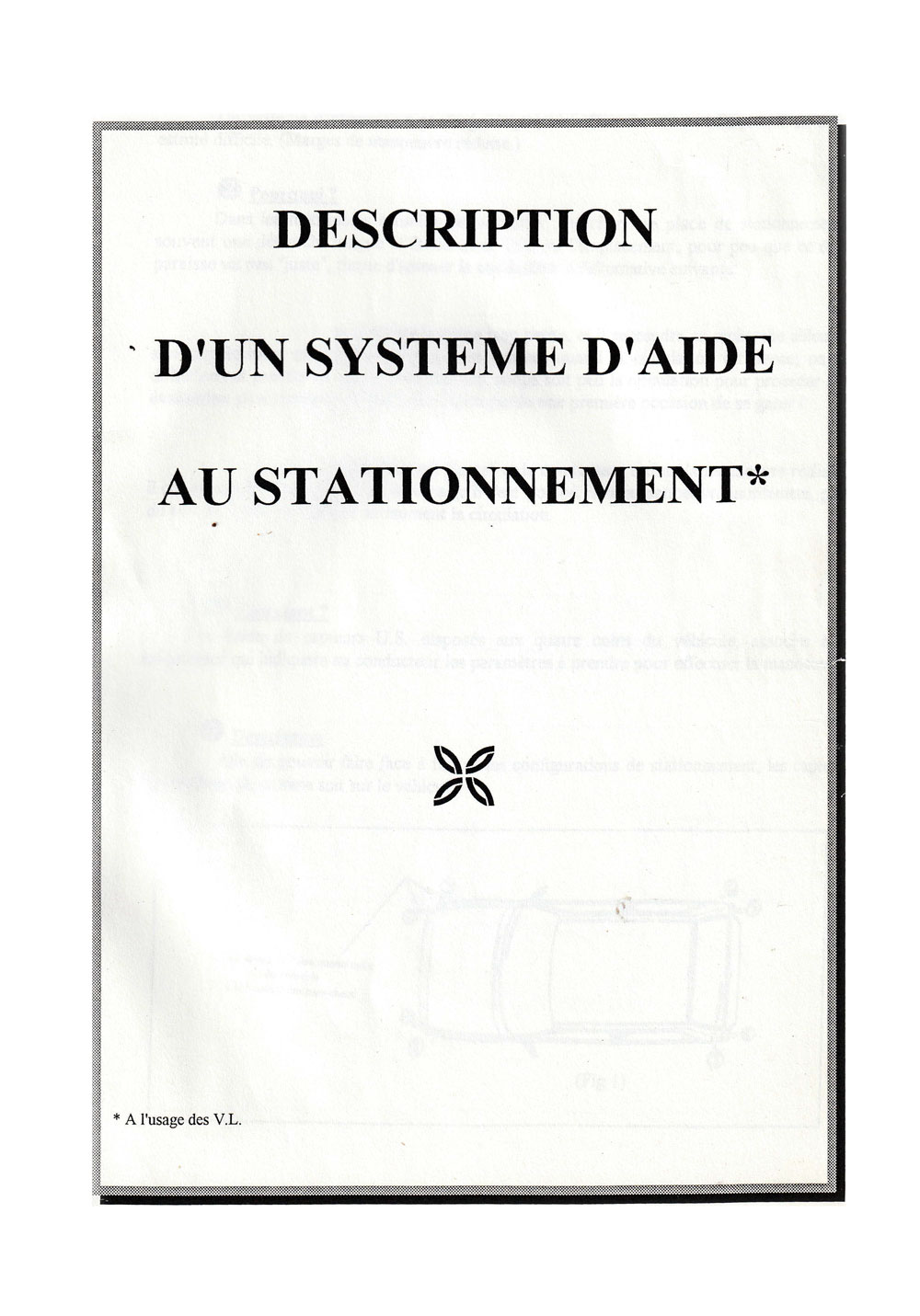
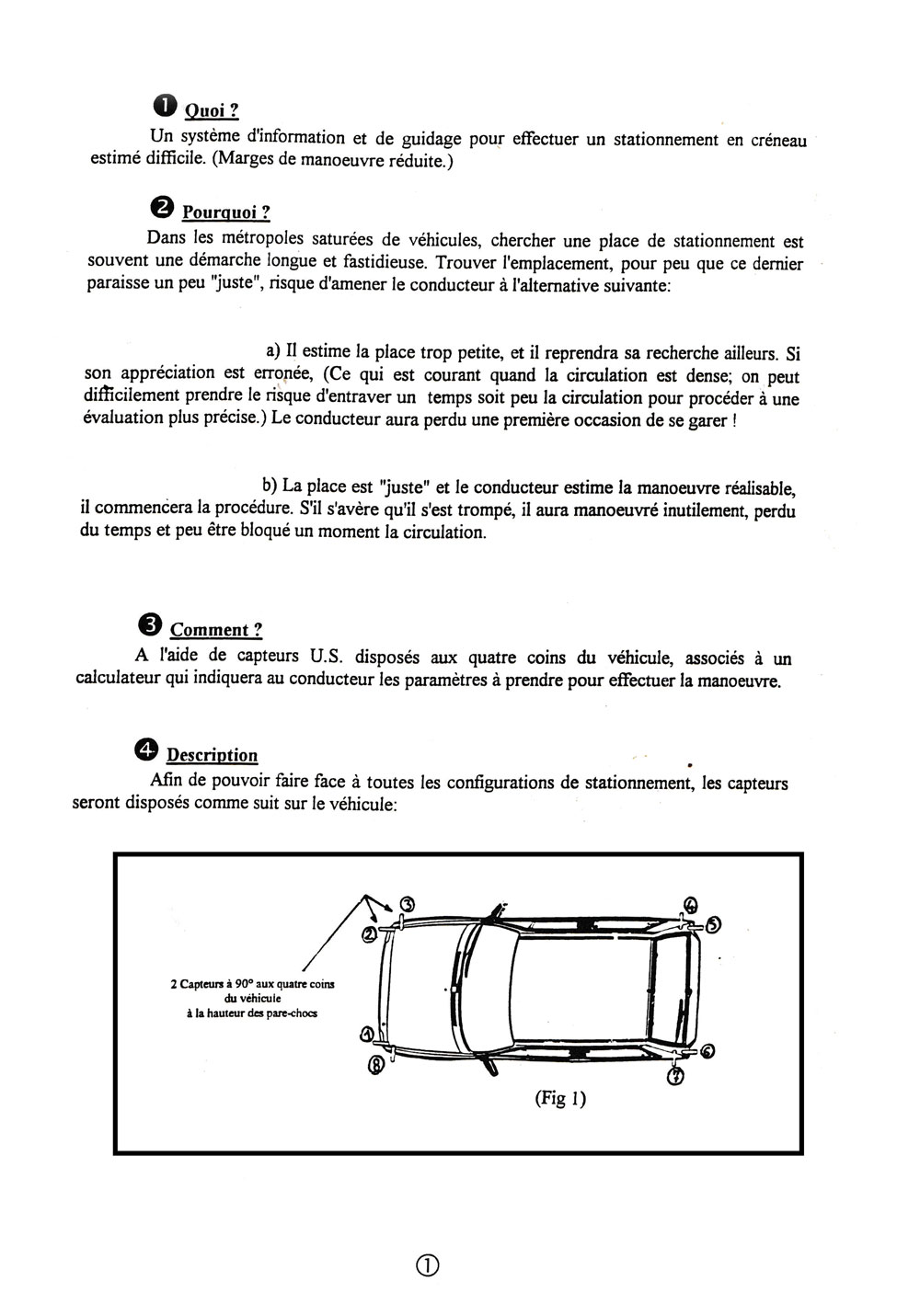
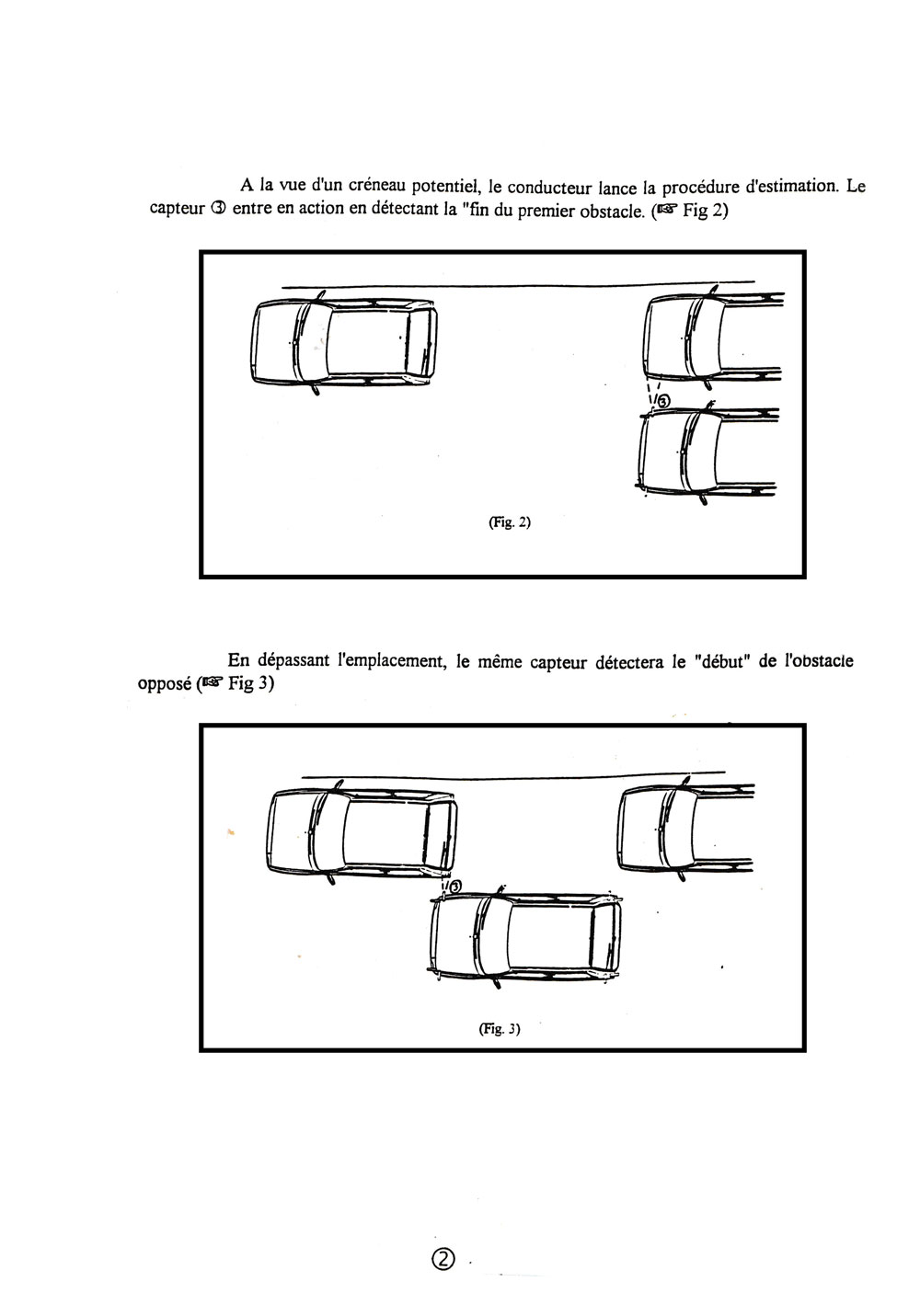
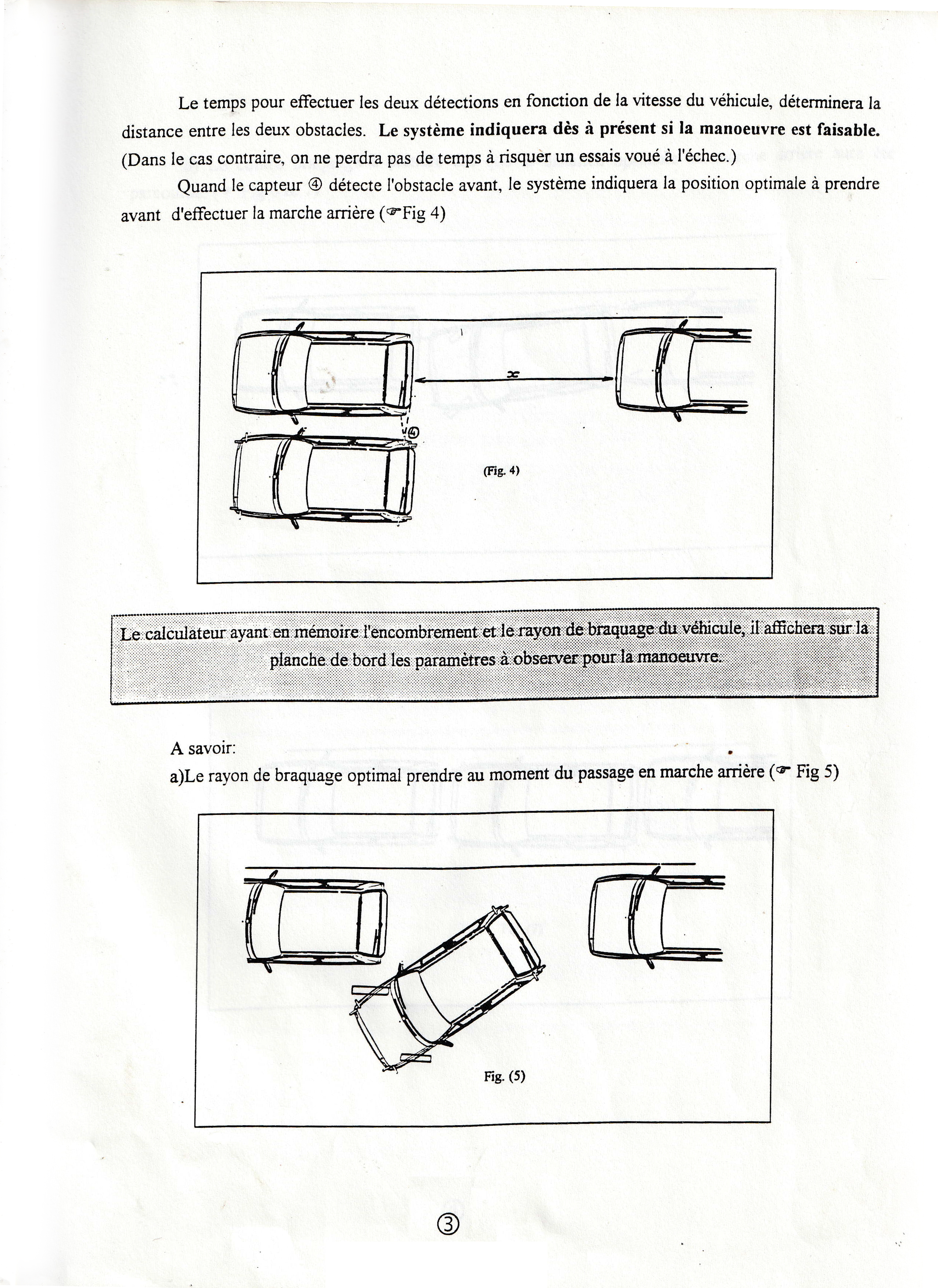
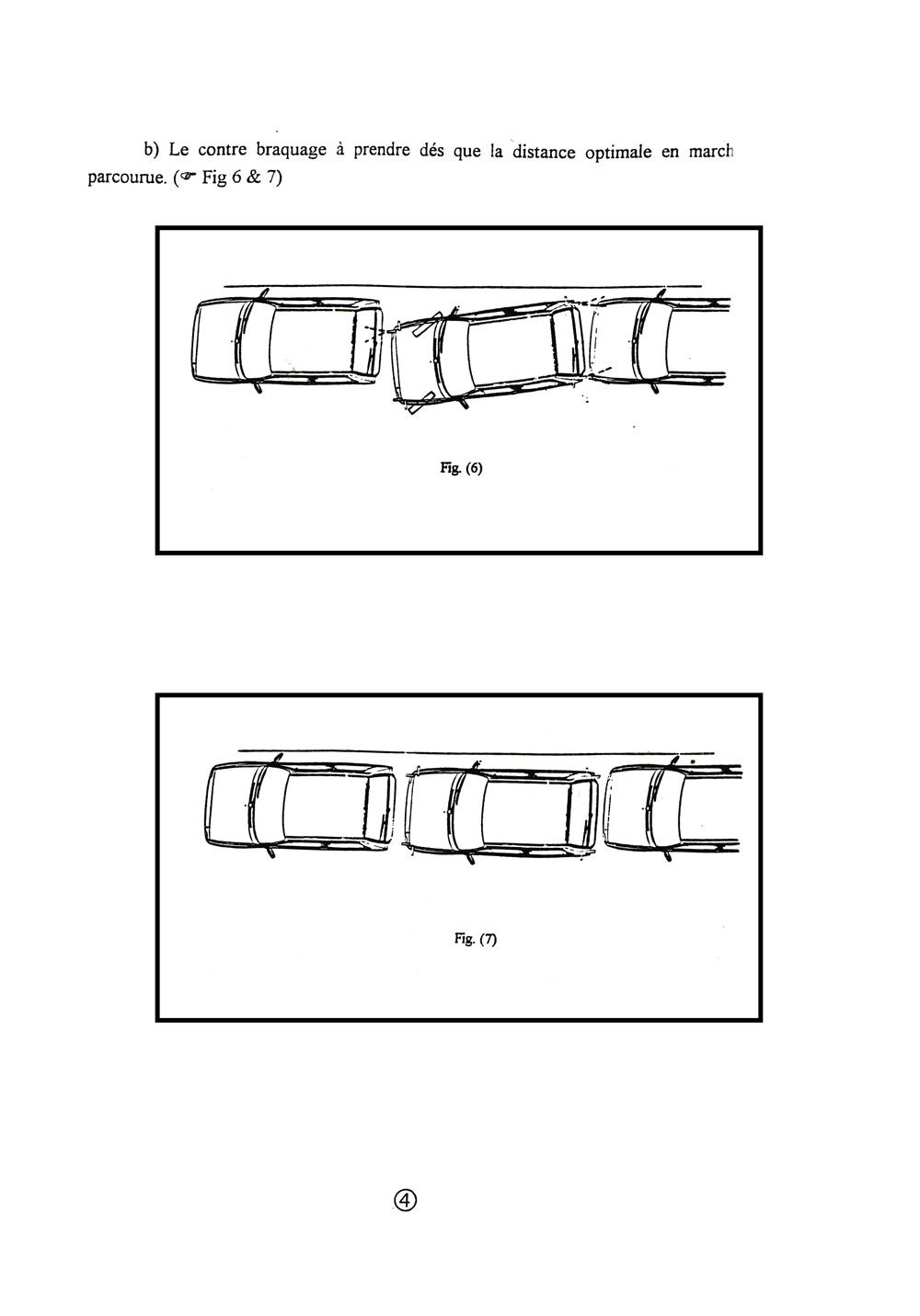
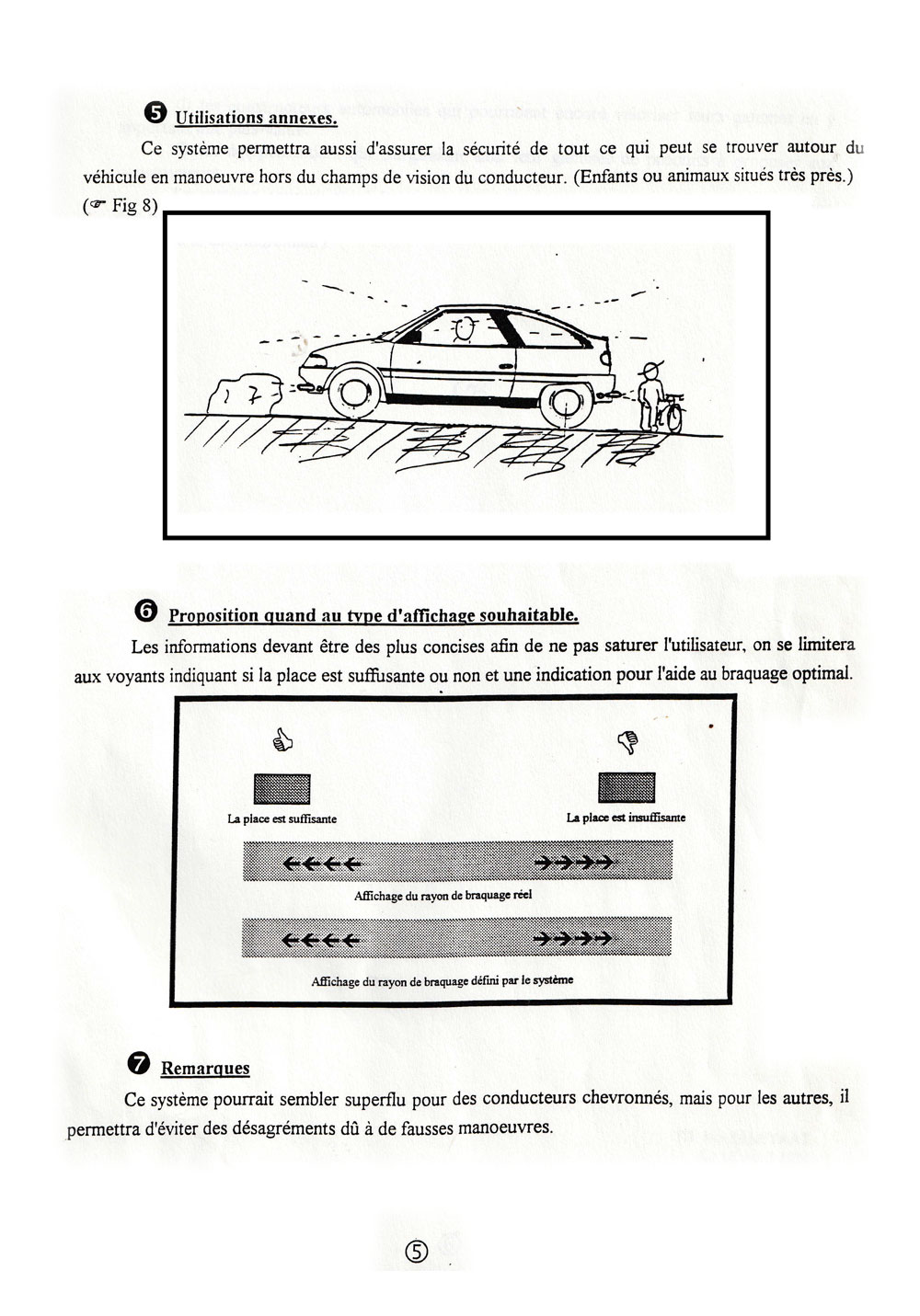
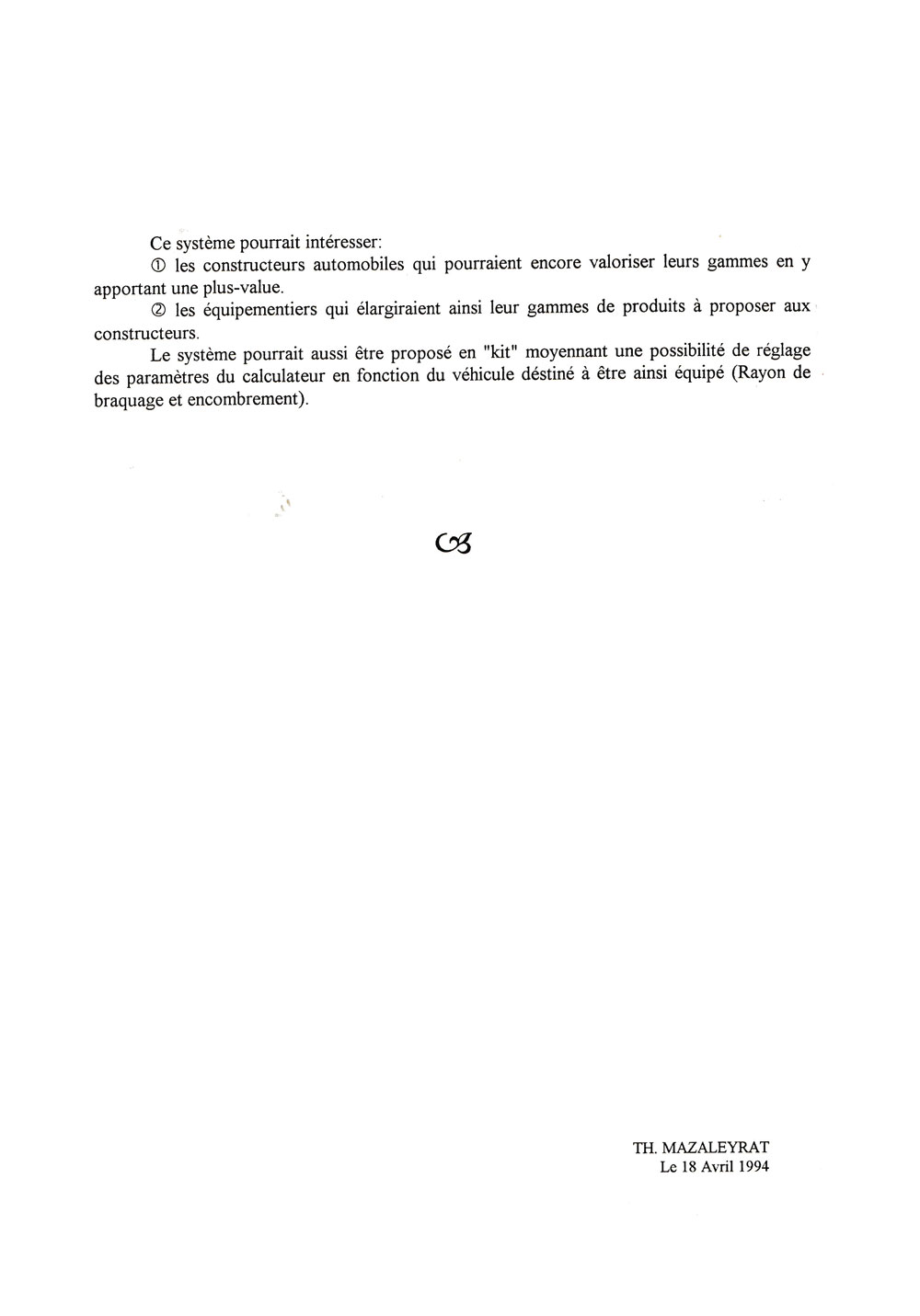
C' est pour les "gonzesses, ça n'éxistera jamais" m'ont répondu quelques esprits éclairés. Mais pourquoi n'ai-je pas fait breveter ce principe ? Bonne question. Peu avant, j'avais fait un autre descriptif quant à un système de déclenchement automatique du "Warning" en cas de freinage violent. Ce système existe maintenant sur certains modèles. Je me suis rendu à l' INPI. Sur place, il m'a été signifié que je devais faire une maquette. Quelle maquette ?
J' ai laissé tomber. Si certains sont à même de vendre de la paille de fer à une jument, je suis incapable de vendre une paire de moufles à un esquimau. Ainsi va la vie... C’est uniquement le niveau de diplôme de me voir proposer des postes d'intérim sans en avoir la moindre expérience. Á savoir, piloter un service d'assistance informatique, gérer des base de données (Le Data Managment comme il est dit en entreprise). Très bien rémunérés au demeurant. Á chaque fois J'y ai créé des outils informatiques qui, d'une part me simplifiait la vie, et d'autre part éliminait tout risque d'erreurs. Et à l'issue de ces missions ce sont les gens impliqués dans le process qui ont hérité de mon outil et de ma charge de travail en sus de la leur. Seulement, je l'avait créé pour moi. Tout ce qui pouvait relever d'une quelconque érgonomie apte à une prise en main aisée et rapide n'a pas été mon soucis premier. j'étais payé pour un résultat. Une formation n'était pas prévue puisque les outils créés ne l'étaient pas non plus. Résultat: pour les personnes qui ont récupéré le fardeau il m'a fallu rédiger des didacticiels pour aider à l'usage de l'outil. Un outil fragile pour qui le découvre. Un bouton appuyé mal à propos et le système part en vrille. Je n'ose imaginer ce qui a pu se passer aprés mon départ. Il n'en reste pas moins que les responsables de plateau n'ayant pas le pouvoir de me recruter se doutaient bien que les activités du service allaient en souffrir. Pour ma part j'allais de facto me retrouver sans emploi, et en cela, j'en étais fort marri. mais c'était ainsi.
U n improbable matin, Je suis contacté par un recruteur pour un poste à Satory en lien avec le développement de véhicules terrestres militaires. Mon profil est « tip-top » pour la fonction. J’en suis ravi, ma période «d’assisté» va se terminer. Après quelques échanges quant à la fiche de poste, le garçon me propose de me rappeler sous peu de jours pour border le sujet. quant à l’habilitation qui va avec. Et fixer une date pour le RV avec le responsable du projet.
Confiant, j’acquiesce.
Satory, relève de la défense nationale. Peut-être ai-je retrouvé une virginité vis-à-vis de la défense nationale. Je vais donc pouvoir apporter mes compétences à un environnement qui, quoi que je puisse en penser, me tient à cœur. Le garçon a tenu parole, il m’a rappelé. Il m’a rappelé pour me signifier que mon profil n'était pas retenu.
Je me hasarde à lui demander une explication.
Il a, me répond-il doucereusement préféré choisir un gars «moins pointu» en terme de profil mais «qui connais la boîte»
Au revoir Monsieur, bien à vous. Peut-être ai-je traversé la mauvaise rue ?
Le prince du moment saura, je n'en doute pas, répondre à la question.

J e me suis aussi essayé au CSO Sans résultats significatifs. La compétition ne me va pas.

P eu avant d'être retraité, j'ai cherché à rejoindre la réserve citoyenne. Une occupation bénévole en lien, bien sûr avec la défense nationale. Suite à quoi, j'ai été convoqué dans les locaux du CESMsur le site de l’École militaire à Paris. Je n'ai pas souvenir de la teneur de cet entretien. Reste que peu de temps après, par courrier, j'apprends que de nouveau, je suis retoqué. J'ai toujours été rêveur et ce malgré les incitations musclées, revêche aux emballements collectifs.


